Partager la publication "L’histoire véridique de la reine Élisabeth Ire (iie partie)"
Par Eon Claude
Résumé : Dans une première partie (Le Cep n°96), nous avons vu comment une histoire secrète éclaire ce règne si important pour l’histoire du Royaume-Uni : les faits, les documents, les recherches dissipent peu à peu les obscurités voulues sur cette malheureuse fille du roi adultère Henry VIII.
Il est important de découvrir que l’abondante iconographie d’Élisabeth montre bien que la Cour savait toutes ces choses, en particulier que la reine, mariée dans l’intimité, eut des fils. Ainsi à Hampton Court, résidence royale, un « portrait d’Élisabeth » devint sans explication, en plein XXe siècle, le « portrait d’une femme inconnue ». Tous ces mystères s’expliquent dès lors qu’on sait que Francis Bacon, le véritable William Shakespeare, était un des fils d’Élisabeth, injustement écarté du trône.
L’iconographie
Fig. 1. Gravure d’Élisabeth Ire dans le livre d’Isaac de LARREY : Histoire d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande, en 4 vol., Rotterdam, Reinier Leers, 1698, par Adriaen van der Werff, gravure intitulée « Queen Elizabeth-Vestal Flame Portrait with two children ».

Chaque portrait du livre de Larray est intentionnellement et systématiquement descriptif de son sujet, chaque détail étant une représentation emblématique et érudite de la vie et du destin du personnage historique qu’il dépeint.
La reine est représentée ornée de perles, symbole de pureté et de maternité, et son portrait est inscrit dans un cadre ovale entrelacé d’olives, symboles de paix, de prospérité et d’abondance. Le portrait montre trois enfants qui sont manifestement sa progéniture. Celui qui est dans l’ombre à droite vêtu d’un linceul et en train d’éteindre la flamme sur l’autel de la vestale, est le premier-né, mort-né ou mort très tôt lorsqu’Élisabeth, âgée d’une quinzaine d’années, fut victime de Thomas Seymour, mari de Catherine Parr1, la dernière des six épouses d’Henry VIII et reine d’Angleterre jusqu’à la mort du roi en 1547. Thomas Seymour était Grand Amiral d’Angleterre et frère d’Édouard Seymour, Lord Protecteur du royaume. Après la mort de son père, Élisabeth avait été confiée à la garde de Catherine Parr. Lorsque cette dernière épousa (secrètement) Seymour, celui-ci se trouva donc sous le même toit qu’Élisabeth dont il avait rêvé d’obtenir la main.
Les historiens « officiels » sont bien obligés de faire état des relations équivoques entre Seymour âgé de 39 ans et Élisabeth, qui en avait 14 ou 15, mais ils se gardent bien de mentionner la grossesse d’Élisabeth. Par exemple, John Ernest Neale, raconte : « Dès les premières semaines de son mariage [avec Catherine], la première chose que [Seymour] faisait fréquemment le matin était d’entrer dans la chambre d’Élisabeth. Si elle était debout, il lui souhaitait le bonjour et lui demandait comment elle allait et lui donnait familièrement une tape dans le dos ou sur les fesses…2 » En réalité les choses allèrent beaucoup plus loin et Élisabeth mit au monde son premier enfant qui disparut aussitôt.
Le peintre, bien informé, plaça cet enfant dans l’ombre, mais lui fait souffler la flamme sur l’autel de la vestale dont la maternité, sans doute involontaire, modifiait radicalement le statut de vestale-vierge.
L’enfant portant des épis de blé et un gouvernail est le second enfant, mais le premier vivant, nommé Francis, qui fut adopté par Nicholas Bacon, Garde des Sceaux et par son épouse Anne Cooke, première dame d’honneur de la reine. Les épis symbolisent son amour de la paix et de la prospérité. Le gouvernail est celui qu’il aurait dû tenir s’il avait été reconnu par sa mère comme héritier légitime de la couronne. L’enfant à gauche est son frère Robert, futur comte d’Essex, semblant parler à son aîné et portant la palme du martyre, un martyre qu’il devra à l’implacabilité de sa mère. Il porte un paludamentum, vêtement retenu par un fermoir sur l’épaule droite et réservé à l’imperator, tout à fait adapté à Robert qui fut le commandant en chef de plusieurs expéditions militaires et, finalement, Lord Lieutenant d’Irlande. Sa rébellion vaine contre la reine et son Conseil devait se terminer par son jugement et son exécution, pour trahison, signée de la main de sa mère.
La précision des symboles, la représentation dans l’ombre de l’enfant mort-né (ou assassiné ?), l’exposition en pleine lumière des deux enfants vivants, prouvent que le peintre avait une connaissance parfaite de la vie privée d’Élisabeth et du sort de ses deux enfants. La présence de l’autel sur lequel brûlait la flamme entretenue par les Vestales est une allusion à la réputation de reine-vierge d’Élisabeth, réputation injustifiée comme le montre le geste extincteur du premier-né. Il existe même un portrait d’Élisabeth enceinte, portrait qui a connu une histoire surprenante, dont nous allons parler maintenant.
Ce portrait, reproduit page suivante, a été connu pendant plusieurs siècles sous le nom de Portrait of Elizabeth. Les experts s’accordent pour penser que c’est l’œuvre de Marcus Gheeraerts le Jeune (1561-1635) et qu’il fut peint entre 1594 et 1604. Ce même peintre est aussi l’auteur d’un autre portrait célèbre, le Ditchley portrait of Queen Elizabeth où l’on voit aussi un poème dans un cartouche et des inscriptions latines.
Ce portrait fut commandé par sir Henry Lee of Ditchley (Oxfordshire) (1533-1611) et il se trouve maintenant à la National Portrait Gallery de Londres.
Le « portrait d’Élisabeth » a connu une histoire assez mouvementée, mais en 1838 la reine Victoria le fit mettre au Hampton Court Palace où il se trouve encore dans un couloir assez étroit et sombre alors qu’il mesure 2,13 m par 1,37 m. En 1898, Ernest Law fit une description de toutes les toiles de Hampton Court et il imprima une photographie du tableau qu’il décrivit comme « la reine Élisabeth dans une robe de fantaisie » (fanciful dress).
Fig. 2. Élisabeth enceinte.

Il précisait : « ce curieux tableau, avec son style fantastique, ses devises énigmatiques et ses vers curieux, a sans aucun doute une signification allégorique que nous sommes incapables d’interpréter. »
Pendant plusieurs siècles, le tableau est resté accroché aux murs de résidences royales et fut connu sous le nom de « Portrait de la Reine Élisabeth ».
Puis, au XXe siècle, quelque chose d’assez remarquable se produisit à Hampton Court où, sans explication, il devint le « Portrait d’une femme inconnue ». Inutile d’interroger les conservateurs successifs sur ce tableau, ils ne répondent à aucune question, et ce tableau ne figure dans aucun catalogue depuis celui de Law en 1898.
De nombreux experts en art ou autres chercheurs ont donné leur interprétation du portrait. Tous ont apporté quelque chose à notre connaissance, mais il faut surtout mentionner les travaux du Dr David Shakespeare, chirurgien retraité, qui, en faisant des recherches sur sa généalogie personnelle, avait été amené à s’intéresser à ce tableau qu’il baptisa The Pregnancy Portrait of Elizabeth I. Même si certaines de ses conclusions ne sont pas exactes, faute de connaître l’histoire et l’œuvre de Francis Bacon, il a fait un remarquable travail que le lecteur est fortement invité à consulter, soit dans sa vidéo soit surtout dans son étude de 92 pages accessible sur internet3. Ses agrandissements des détails peu visibles sur les reproductions du tableau sont indispensables pour le déchiffrement des allégories. Que la langue anglaise du bref commentaire des images ne décourage personne !
Ce que la plupart des commentateurs n’ont pas vu est la corrélation entre Élisabeth, Francis Bacon et William Shakespeare. Or c’est la clé pour comprendre le tableau. Le seul qui s’en soit approché le plus près est David Shakespeare, dont nous allons suivre la démarche. Il commence par faire remarquer que ce portrait a fait l’objet de profondes altérations et fut repeint, laissant penser que l’Establishment cache quelque chose que le public ne doit pas connaître.
Le changement de nom du tableau en plein XXe siècle, de « Reine Élisabeth » à « Portrait d’une femme inconnue » ne se comprend que si ce portrait de femme enceinte ne doit en aucun cas être celui d’Élisabeth, la « Reine-vierge ».
Le sujet est une jeune femme sans sourire, debout devant un arbre avec des arbrisseaux en arrière-plan. Elle porte une robe4 avec de nombreux motifs, couverte d’une écharpe transparente. Elle a une coiffure et un voile ressemblant à des modèles turcs. Autour du cou, elle porte un cordon auquel deux bagues sont attachées. À côté d’elle se trouve un cerf pleurant qu’elle couronne de pensées. À la gauche de la peinture, sur le tronc de l’arbre, figurent trois inscriptions latines. Dans l’arbre lui-même on voit deux pinsons mâles superbement colorés. À droite du tableau, un cartouche contenant un sonnet dont le sujet est « chagrin et perte ». À l’arrière-fond, un bassin avec des arbres puis un paysage s’estompant. Une grande partie du tableau est sombre avec des lignes confuses et indistinctes, surtout à droite sous le coude du sujet, résultat de ce qui semble être un repeint assez grossier.
Que la jeune femme soit enceinte n’a jamais été mis en doute, dans aucun commentaire des critiques artistiques : il y a trop de symboles de fécondité, sans parler de la robe elle-même comme le montre David Shakespeare par une analyse précise des plis de la robe ainsi que par le fait que les deux bagues suspendues à son collier ne tombent pas verticalement comme ce devrait être le cas. Cette jeune femme est bien enceinte, faisons confiance au chirurgien.
Un problème surgit avec le voile partant du sommet de la coiffure, car il a manifestement été repeint pour cacher quelque chose. Grâce à la photographie de 1898, on peut voir qu’il s’agissait de faire disparaître le « R » pour « Regina » qui parsemait ce voile. La coiffure d’Élisabeth ressemble à celle de Hurrem Sultan, « Roxelana », épouse de Suleiman le Magnifique, peinte par Le Titien en 1550. Sur ce dernier tableau, on remarque un gros bijou sur le front de la princesse au milieu de la coiffe.
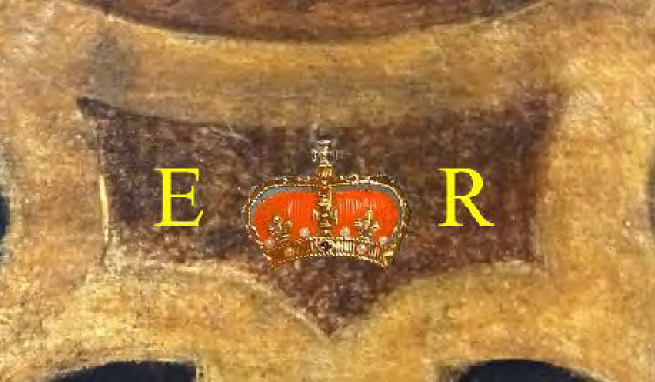

Fig. 3. En haut: ce que l’on devrait voir ; en bas ce que l’on voit aujourd’hui.
Dans le cas d’Élisabeth, on constate que sa coiffure est parsemée de pensées, sa fleur préférée, et il est probable que la peinture initiale comportait un bijou sur le front qui a disparu, sans doute parce qu’il dénotait trop une figure royale. Notons que William Shakespeare mentionne Suleiman le Magnifique dans Le Marchand de Venise, acte 1, scène 2.
Dans les portraits de cette époque, on voit rarement les souliers du personnage. Ici ils ressemblent davantage à des pantoufles de luxe. Ils sont ornés de perles bleues, les plus rares de toutes, et toutes de la même teinte de bleu.
Il y a aussi, sur chaque soulier, trois perles roses pâles serties dans un bijou en or et formant une rose. Chaque cheville est ornée d’un grand rubis et des fils d’or sillonnent le soulier. Manifestement la personne portant de tels souliers devait être de haut rang.
L’examen de l’oreille gauche du sujet montre des choses bizarres. À côté des deux perles pendant du lobe se trouve un gros pendentif attaché à la chevelure. Le Dr Altrocchi5 suppose que cette grande tache brune aurait pu être un armillaire. À la Renaissance, c’était le symbole de la sagesse et du savoir et, comme tel, il fut un emblème de la reine Élisabeth. On le retrouve dans le Ditchley portrait, non maquillé cette fois. L’armillaire était le symbole exclusif d’Élisabeth, et on peut penser que son effacement dans le Pregnancy portrait venait de la volonté de masquer son identité.
David Shakespeare analyse longuement la robe et ses motifs de fleurs et d’oiseaux, tous porteurs de symboles. Il isole la partie de la robe où se superposent les deux bagues attachées au cordon que porte Élisabeth.
Fig. 4. Motif hautement symbolique de la bague.

Les deux fruits sont des figues et, dans la culture gréco-romaine, la figue est associée aux organes génitaux féminins et à la fertilité. La présence de ces deux figues représente les deux fils d’Élisabeth, la langue sous la bague du haut évoque Francis, l’orateur et l’écrivain, et la branche de laurier sous la bague d’en bas désigne Robert d’Essex, le militaire glorieux. Ceci est mon interprétation personnelle, car David écrit seulement : « Au centre, il y a deux figues, ouvertes toutes les deux. En tant que symboles de fertilité cela signifie-t-il la naissance d’une double progéniture ? Pourrait-on interpréter cela autrement ? Je pense que non. » Les noms de Francis Bacon et Robert Essex ne sont jamais cités dans son opuscule…
L’arbre à gauche, sur le tableau, est un noyer, originaire du Proche-Orient et considéré comme un arbre royal à l’époque d’Élisabeth. Le noyer royal symbolise la sagesse et le savoir. Sur les branches de l’arbre on voit deux pinsons, l’un au-dessus de l’autre, qui pourraient représenter deux jeunes hommes : les enfants d’Élisabeth ? La partie supérieure de l’arbre est dans l’ombre mais, en éclaircissant, on distingue un oiseau-chanteur perché sur une branche.
En 1725, George Vertue (1684-1756), graveur et antiquaire, lorsqu’il vit le tableau, nota qu’il y avait des oiseaux en vol, alors qu’il n’y a aucun oiseau en vol visible aujourd’hui. Par contre, on voit deux noix mal reliées à l’arbre et de forme assez curieuse. David Shakespeare pense qu’on a peint ces noix sur les oiseaux en vol. Mais pourquoi ? Il pense que ces deux oiseaux volaient vers l’oiseau chanteur.
En 16016 avait été publié un poème de Shakespeare, The Phoenix and the Turtle, soit le Phénix et la tourterelle. Il débute ainsi :
Que l’oiseau le plus bruyant / Let the bird of loudest lay
Sur l’arbre seul d’Arabie / On the sole Arabian tree
Soit le sombre héraut, la trompette / Herald sad and trumpet be
Au son duquel les chastes ailes obéissent. / To whose sound chaste wings obey.
Ce poème allégorique de 67 vers7 raconte l’histoire d’un amour mystique entre deux oiseaux : la tourterelle, symbole de fidélité, et le phénix mythique, emblème de l’immortalité. Le poème pleure la mort du phénix et de la tourterelle, et son thème de l’amour mutuel explore la complexité de l’union mystique des deux oiseaux morts. Il s’agit du plus obscur poème de Shakespeare et, comme le dit Helen Hackett, « il demande à être décodé », ce que beaucoup ont tenté de faire en se référant à des personnages historiques8. Le plus probable est que le phénix représente en même temps la reine Élisabeth et son héritier et successeur. Dans ce thrène, son auteur véritable, Francis Bacon, se lamente qu’Élisabeth ne laisse pas de postérité avouée, en l’occurence lui-même, son enfant caché, héritier non reconnu du trône d’Angleterre :
La beauté, la loyauté et la perfection
La grâce dans toute sa simplicité
Gisent ici réduites en cendres.
La mort est maintenant le nid du phénix
Et le sein loyal de la colombe
Repose sur l’éternité.
Ils n’ont pas laissé de postérité
Et ce n’était pas chez eux infirmité,
Leur union était le mariage de la chasteté9.
Dans la dernière scène de son Henry VIII, Shakespeare met sur les lèvres de Cranmer un grand discours. Dans ce discours, il « prophétise » que le bébé princesse Élisabeth, bien que décrite comme « un phénix vierge » laissera derrière elle un fils et héritier qui « s’élèvera telle une étoile aussi célèbre qu’elle-même le fut10 ». Il s’agit évidemment de Francis Bacon, alias Shakespeare. Le Pregnancy Portrait of Elizabeth dit-il autre chose ?
En bas à droite du tableau, se trouve un cartouche contenant un poème. Le cartouche a fait l’objet de retouches pour masquer les E et R séparés par une couronne royale (cf. Fig. 3 ci-dessus).
La disposition du poème, un sonnet de 3 strophes de 4 vers, suivi d’un couplet de 2 vers, l’espacement irrégulier des mots, certaines lettres en capitales sans raison apparente, tout cela fait penser que ce texte recèle un message à décoder.
Cela est typique de Bacon, grand inventeur et utilisateur de codes11. Le poème comprend 111 mots, soit « Bacon » dans le code K, où le K a valeur 10 et le I, dernière lettre du poème, 35.
Ce poème exprime la peine dont il [F. Bacon] a souffert et qui tourmente encore son esprit sans repos en revivant et rappelant les torts de son passé : sa naissance cachée et le déni de ses droits de naissance en tant qu’héritier du trône royal d’Angleterre. Les larmes de mélancolie du cerf pleurant représentent ses propres larmes silencieuses et son supplice ignoré, dû à la perte de son héritage royal. Tout son espoir repose sur le grand arbre d’Orient sous lequel se trouve sa mère, la reine Élisabeth pour laquelle il a donné beaucoup d’amour et d’attention.
Mais il sait maintenant que tout cela fut en vain. Car désormais il réalise trop tard qu’il devra pour toujours se débattre sur le cruel rocher (la coque) du destin, alors que l’amande (le « noyau », kernel, la chose la plus importante), son statut de fils et héritier de la couronne royale, sera hérité par d’autres12.
Il a toutes les raisons de se plaindre puisqu’il demeure non reconnu et déshérité, et il craint que ce soit là tout le fruit que cet arbre royal, sa royale mère Élisabeth, porte et lui lègue13.
En conclusion, on peut résumer ainsi la signification de ce portrait : La reine Élisabeth enceinte a donné naissance à son fils royal caché, Francis Tudor, connu dans le monde sous le nom de Francis Bacon, l’auteur secret des poèmes et des pièces de Shakespeare. Au cœur du tableau, la main d’Élisabeth s’étend sur la tête du cerf en larmes, qui, plusieurs commentateurs l’ont compris, représente celui qui a commandé cette peinture. Le cerf en pleurs évoque Actéon, un chasseur orgueilleux transformé en cerf par Diane après qu’il a surpris celle-ci prenant son bain, entièrement nue. Or, Actéon en cerf présuppose la fameuse rencontre avec la déesse et, comme dans le cas des pensées-fleurs, il ne pouvait y avoir qu’une seule Diane dans l’Angleterre élisabéthaine, la Reine-Vierge elle-même. Le thème d’Actéon métamorphosé en cerf, tiré d’Ovide, se retrouve dans plusieurs pièces de Shakespeare : Titus Andronicus (2:3), The Merry Wives of Windsor (2:1), As You Like It où, dans le second acte, le cerf larmoyant apparaît (2:1). Dans Hamlet, acte 3 scène 2, Hamlet s’écrie :
Laissons le cerf blessé gémir
Et fuir la biche vagabonde :
Tel doit veiller ; tel peut dormir.
Ainsi va le monde14.
Le livre du professeur Jonathan Bate, Shakespeare and Ovid, et l’article de François Laroque Ovidian voices in Marlowe and Shakespeare : the Actaeon variations15 soulignent l’intérêt intriguant de Shakespeare pour l’histoire d’Actéon.
« Actéon représente un mystérieux point crucial qui a besoin d’être décodé. »
Bacon est revenu sur le sujet dans son Wisdom of the Ancients, dans sa fable Acteaon and Pentheus ; or Curiosity à propos de « la découverte des secrets », c’est-à-dire des secrets cachés des rois et reines, tel que les grands secrets cachés dans le Pregnancy Portrait.
L’interprétation du mythe d’Actéon et de son thème central du secret représente un commentaire textuel du Pregnancy Portrait et de la vie de la personne cachée qui a commandé ce tableau dans lequel il est transmué en cerf. Celui-ci a passé la plus grande partie de sa vie dans la peur comme le bâtard secret de son royal géniteur, en homme chassé comme Actéon par ceux qui connaissaient son statut royal. De fait, son « cousin », Robert Cecil, le poursuivit de sa jalousie jusqu’à provoquer sa chute finale.
Revenons au tableau où nous voyons le cerf couronné de pensées – la fleur préférée d’Élisabeth – par la main royale. Quelle personne est représentée par ce cerf ? Qui est cette personne invisible transmuée en un tel cerf pleurant ? C’est Francis Tudor Bacon, fils caché de Robert Dudley, comte de Leicester, et de sa femme la reine Élisabeth, l’héritier de la couronne royale dont la naissance a été gardée secrète par la « Reine Vierge ». Pour des raisons à la fois privées et politiques, elle n’a jamais voulu reconnaître publiquement et officiellement, sinon par accident comme nous l’avons vu, son mariage et la naissance de ses deux enfants Francis et Robert, privant ainsi Francis de sa légitime succession.
C’est pourquoi Francis Tudor, métamorphosé en cerf, pleure dans le Pregnancy Portrait parce qu’il ne sera jamais reconnu et couronné en tant que Francis I King of England.
Conclusion
L’ensemble des faits et documents rapportés ci-dessus sont évidemment accessibles, et depuis longtemps, à tous ceux qui se donnent la peine de les chercher. Les historiens, officiels ou non, ne peuvent pas ignorer ce faisceau d’arguments textuels et picturaux. Alors pourquoi ce travestissement de la vérité, pourquoi maquiller ce tableau d’Élisabeth enceinte, si riche en symboles certes cachés mais finalement déchiffrables ? On peut comprendre que, pour des raisons politiques, pour entretenir l’espoir chez les prétendants au mariage, Élisabeth ait voulu cacher sa vie privée, gageure hasardeuse, téméraire, pour la reine d’Angleterre… Mais elle a quitté ce monde en 1603 ; sa dynastie est éteinte et le rôle des historiens n’est-il pas de faire connaître les secrets qu’on ne pouvait pas dévoiler à l’époque ? On ne peut que constater l’acharnement des historiens et conservateurs de musées à nier la double maternité de la « reine vierge ». Ce qui conduit parfois à des absurdités, ainsi celle qui consiste à présenter Essex comme l’amant d’Élisabeth alors qu’il est son fils et qu’il le sait. Le protestantisme naissant en Angleterre avait-il besoin d’une image de reine vierge pour concurrencer la véritable Vierge catholique ?
La vérité est qu’il est très difficile de dissocier la reine Élisabeth, son fils Francis et Shakespeare. Il se peut d’ailleurs que le vrai but de la négation de la filiation royale de Francis Bacon soit d’empêcher sa reconnaissance comme étant Shakespeare. Les défenseurs du Shakespeare de Stratford-upon-Avon sont – c’est bien naturel – farouchement opposés à Francis Bacon. Et pourtant la raison pour laquelle Francis a été obligé de masquer sa véritable identité est qu’il ne pouvait pas écrire sous son véritable nom.
Il a utilisé de nombreux prête-noms, dont celui de William Shakespeare, en accord (rémunéré) avec celui-ci. L’œuvre de Shakespeare, pour qui sait la lire, est replète d’allusions à des faits ou des personnages que Bacon seul pouvait connaître. Ne pouvant dire ouvertement ce qu’il voulait faire savoir à la postérité, il eut recours au théâtre et à la poésie, ainsi qu’au langage codé, pour exprimer ses pensées les plus profondes. Ce n’est que dans l’une de ses dernières œuvres publiées que Francis a donné la clé de ses codes, car il ne voulait pas que les vérités qu’il annonçait fussent découvertes trop tôt. Il fallut attendre la fin du XIXe siècle pour que de patients chercheurs découvrissent ce langage codé, qui apporta en effet des révélations extraordinaires sur Élisabeth et son époque. Cacher la maternité d’Élisabeth, la véritable filiation de Francis Bacon, c’est tout simplement s’interdire de comprendre l’œuvre de « William Shakespeare », le parangon de la littérature et de la culture anglaises.
Bibliographie
- DODD Alfred, Francis Bacon’s Personal Life-Story, Rider & Cy, 1986.
- OWEN Orville W., Sir Francis Bacon’s Cipher Story, 5 vol., 1894.
- GALLUP Elizabeth Wells, The bi-literal cypher of Sir Francis Bacon discovered in his works and Deciphered, (1899).
- KUNOW Amelie Deventer von, Francis Bacon Last of the Tudors, (1924).
- SHAKESPEARE David, The Pregnancy Portrait of Elizabeth I, (2018).
- FROUDE James Anthony, History of England, vol. VI,Elizabeth, (1893).
1 Thomas Seymour (1508-1549) ; Catherine Parr (1512-1548).
2J. E. NEALE, Queen Elisabeth I, Penguin Books, 1934 / 1960, p. 26.
3 // drive.google.com/open?id=1Q63
4 On qualifiera ce vêtement de « robe » bien qu’il soit très éloigné des robes élisabéthaines. Il ressemble davantage à une « robe de chambre », mais ce genre de vêtement n’existait pas à l’époque d’Élisabeth.
5 The Queen Elizabeth Pregnancy Portrait: Who designed it and who did the cover-ups ?
6 La relation entre ce poème et le tableau laisse supposer que la peinture doit être proche de 1601 ou de 1603, date de la mort d’Élisabeth.
7 67 = Francis en code simple.
8Helen HACKETT, Shakespeare and Elizabeth : the meeting of Two Myths, Princeton UP, 2009, p. 137.
9 Traduction de François-Victor HUGO
10 Shall star-like rise as great in fame as she was.
11 Il est l’inventeur du code binaire qui fut utilisé pour le code Morse et maintenant pour l’informatique. Bacon utilisait les lettres a et b ancêtres du 0 et 1 actuels.
12 The shales be mine, the kernels others are.
13 David Shakespeare donne page 46 une reproduction exacte du poème.
14 Traduction d’André GIDE in Shakespeare, t. 2, Paris,NRF, La Pléiade, 1963, p 661.
15 In Shakespeare’s Ovid The Metamorphoses in the Plays and Poems. Cambridge UP, Éd. A.B. Taylor, 2000.
