Partager la publication "Le spectre de Galilée"
Par Tassot Dominique
Résumé : Sur bien des sujets, mais tout spécialement sur les chronologies et datations, les théologiens se montrent souvent réticents, dès lors qu’il est question de confronter les données bibliques avec les chiffres établis par les historiens. La sortie habituelle consiste à déclasser le texte biblique en allégorie, en conte pédagogique voire en poésie. Il faudrait éviter tout conflit avec la science, par principe. Cette attitude irrationnelle a cependant sa raison d’être : la crainte d’une nouvelle « affaire Galilée », mais une crainte réflexe, mue par le cerveau limbique, et que la véritable histoire de Galilée ne justifie pas. C’était son adversaire, le cardinal Bellarmin, qui avait adopté la véritable démarche épistémologique : exiger des preuves de la nouvelle thèse affirmée. Aujourd’hui, où la certitude monolithique de la Physique s’est évaporée, notamment de par la théorie de la Relativité, il importe que l’Église se ressaisisse, reprenne confiance en l’autorité intellectuelle de la Révélation et rende à l’humanité le service de replacer la science à sa noble mais juste place au sein de la vision chrétienne du monde.
Lorsqu’on veut savoir, au-delà des institutions, qui a réellement du poids dans un pays, il existe un critère simple et commode. Il suffit de poser la question : de qui est-il dangereux de dire du mal ? De manière analogue, en examinant certaines anomalies des discours théologiques, on en vient à se demander si une influence externe n’est pas venue perturber – ou plutôt dévier – les pensées, les faire sortir de la droite ligne du raisonnement, donner un crédit indu à une autorité intellectuelle étrangère à la Révélation.
Un exemple significatif nous est donné dans le Manuel d’Écriture Sainte du chanoine Verdunoy, en usage dans les séminaires de la première moitié du siècle dernier. Ce manuel s’ouvre par une Table chronologique mettant en parallèle, sur plusieurs colonnes, les dates admises pour l’histoire de l’Égypte, de la Palestine, ou de l’Asie Mineure, dates imprimées de diverses manières selon leur degré de certitude : certaine, probable, résultant d’une donnée chronologique traditionnelle, proposée hypothétiquement par les chronologistes, inconnue.
Ce tableau est « destiné à interpréter, en fonction des connaissances historiques actuelles, les données chronologiques contenues dans la Genèse et dans l’Exode »1.
Il s’agit donc de situer dans le temps l’histoire des patriarches puis celle du peuple hébreu. Or la généalogie des patriarches est donnée, avec leur âge à la naissance de leur premier-né, dans le texte même de la Genèse. C’est le procédé en usage dans l’Antiquité pour marquer les temps : on compte en années de règne du souverain et, par addition, en découle une durée pour chaque dynastie. Notre manière actuelle de situer les événements sur un axe universel, les datant en années avant ou après Jésus-Christ, est une invention tardive, marquant l’avènement d’une chrétienté universelle. Comment se fait-il alors que le Manuel déclare d’emblée : « Il n’y a pas de chronologie biblique »2 et n’introduise la lignée des patriarches dans son tableau qu’à partir de Tharé, père d’Abraham, quittant Ur en Chaldée et s’installant à Haran en Mésopotamie « vers 2150 ? »3. Quant aux grands événements antérieurs (création du monde, création de l’homme, Déluge et dispersion des descendants de Noé), ils sont simplement signalés hors tableau avec la mention « à date inconnue4 ».
Ainsi les historiens profanes auraient-ils établi une chronologie de l’Antiquité, certes avec bien des désaccords et des degrés de certitude très variables, tandis que l’historien sacré, certes avec des variantes entre traducteurs et interprètes et donc avec des degrés de certitudes très divers, aurait été incapable de fonder une chronologie de l’humanité. Pourquoi interpréter les dates de la Genèse en fonction des tables profanes, et non l’inverse ?
Pour s’en justifier et bien montrer la dispersion des computs bibliques, le manuel signale : « déjà en 1738 un chronologiste notait, pour l’intervalle entre la Création du monde et Jésus-Christ, plus de 200 calculs différents, allant de 3483 à 6984, par conséquent avec une différence de 35 siècles5. »
Outre que le rôle des historiens devrait être précisément d’étudier attentivement tous les calculs, afin de réduire les écarts et – si possible – de les éliminer, il n’est pas interdit de remarquer que cet écart de 35 siècles est précisément celui que l’on retrouve entre les diverses chronologies de la seule Égypte6.
Le manuel de Verdunoy ne fait ici que reprendre une tradition faisant autorité, puisque le grand Dictionnaire de la Bible dirigé par Fulcran Vigouroux, à l’article « Chronologie biblique » (donc en 1899), adoptait déjà cette approche :
« On ne trouve pas dans la Bible une chronologie toute faite ni une ère ou époque fixe à laquelle commence la numération des années, et dans ce sens on peut dire, en répétant la parole qu’on attribue à Sylvestre de Sacy : “Il n’y a point de chronologie biblique” » (col. 718).
« I. DATE DE LA CRÉATION DU MONDE. – La Bible ne la fixe pas ; elle dit seulement que Dieu créa le ciel et la terre “au commencement”, sans préciser l’époque de ce commencement » (col. 719).
« II. DATE DE LA CRÉATION D’ADAM. – Les temps bibliques ne peuvent se mesurer qu’après l’apparition de l’homme sur la terre. Toutefois le texte sacré ne détermine pas chronologiquement l’origine de l’homme d’une manière formelle et précise ; nulle part il ne dit : Adam a été créé à telle date » (col. 720).
En 1945 encore, la 5e édition du Manuel d’Ecriture Sainte de Renié affirme clairement : « La date de la création du Monde est une question qui relève de la science » (p. 460).
On voit donc se profiler une dissymétrie entre sciences profanes et sciences sacrées : au savant profane l’autorité pour établir le cadre chronologique dans lequel le bibliste va s’insérer. En dehors de ce cadre, vers les débuts de l’humanité, là où l’historien profane se tait, le bibliste, pourtant le seul à disposer de données chronologiques, rentre dans sa coquille et ne laisse à la vue qu’un écriteau « date inconnue » !
Certes, les durées servant aux computs profanes sont gravées sur des tablettes et des stèles, tandis que les durées bibliques ne furent gravées que dans la mémoire du peuple hébreu7. Mais dans les civilisations de tradition orale, les récits sont composés et mémorisés selon des procédés assurant tant la transmission fidèle que la compréhension du message transmis, tandis que notre déchiffrage des stèles et tablettes est loin d’être parfait : nul besoin d’étudier longtemps l’épigraphie pour s’en convaincre ! Cette volonté d’aligner l’exégèse – interprétation de la Bible – sur les sciences profanes, ce que Houtin nommait le « concessionnisme », est donc l’adaptation perpétuelle à un donné extérieur auquel, n’ayant aucune prise sur lui, on ne peut que se plier.
Tout se passe comme si l’ecclésiastique érudit était ipso facto placé sous tutelle par la science universitaire, sans que cette dernière eût à justifier son privilège. La légitime autonomie intellectuelle de chaque science ne vaudrait, au fond, que pour le savant qui opère hors de l’Église, le seul assuré de son autorité. C’est ainsi que l’Académie pontificale des Sciences, pour acheter son crédit au sein du monde savant, recrute les deux tiers voire les trois quarts de ses membres parmi les athées ou les agnostiques.
Un cas emblématique fut celui de Stephen Hawking, athée militant dont le dernier livre s’intitule : Y a-t-il un grand architecte dans l’Univers ? 8
Dans une Église en ordre, recruter une majorité d’académiciens athées serait perçu comme absurde, ou encore comme la preuve que la foi nuit à la science, l’aveu honteux qu’il ne serait pas possible, même à l’échelle mondiale, de trouver une trentaine de scientifiques catholiques reconnus ! Telle n’est pas, à l’évidence, la véritable explication. Autre exemple : le Ratzinger Schulerkreis de 2006. Chaque année, le cardinal Ratzinger avait coutume de réunir ses anciens doctorants pour une session d’études de trois jours portant sur un thème précis. La réunion se poursuivit après son élection pontificale et, en 2006, le sujet retenu fut l’évolution. Un biologiste catholique de talent, titulaire de deux doctorats et chercheur à la Smithsonian Institution, à Washington, avait été pressenti pour intervenir et avait préparé sa communication. Mais elle ne fut pas même distribuée aux participants9, le seul scientifique admis dans le cercle fut le professeur Schuster, biochimiste, président de l’Académie autrichienne des sciences et connu comme athée et évolutionniste.
Il existerait donc les « vrais » scientifiques – athées ou agnostiques – et les autres, toujours suspectés d’un biais religieux. Dans le même ordre d’idées, notons que le Vatican avait confié les relations avec la communauté scientifique au Conseil pontifical pour le dialogue avec les non-croyants10.
Il n’est pas difficile de remonter à la source de ce complexe d’infériorité collectif : l’affaire Galilée, le premier cas – mais emblématique – de « repentance »11.
Le document conciliaire Gaudium et Spes, au numéro 36, énonce en effet : « Qu’on nous permette de déplorer certaines attitudes qui ont existé parmi les chrétiens eux-mêmes, insuffisamment avertis de la légitime autonomie de la science [ob non satis perspectam legitimam scientiae autonomiam].
Sources de tensions et de conflits, elles ont conduit beaucoup d’esprits jusqu’à penser que science et foi s’opposaient 12. » Une note de bas de page fait ici référence explicite à la vie et l’œuvre de Galilée : « Cf. PIUS PASCHINI, Vita e opere di Galileo Galilei, 2 vol., Vatic., 1964. »
Or, si le souverain bien consiste à éviter les conflits, la seule manière d’y parvenir a priori consiste à donner d’avance raison à l’adversaire, avant même qu’il n’ait eu à exposer ses arguments. On sait qu’à l’époque du procès de Galilée, ses juges avaient poussé l’impudence jusqu’à exiger du savant qu’il prouvât ce qu’il affirmait : le mouvement absolu de la terre. Il en était bien incapable, et la question n’a donc jamais porté sur l’autonomie, légitime ou non, de la science. Bellarmin, qui avait lui-même enseigné l’astronomie, était parfaitement conscient qu’un modèle héliocentrique pouvait valablement concurrencer les épicycles de Ptolémée. Il écrivait au P. Foscarini, le 12 avril 1615 : « Dire qu’en supposant le mouvement de la terre et la stabilité du soleil toutes les apparences célestes s’expliquent mieux que par la théorie des excentriques et des épicycles, c’est parler avec un excellent bon sens, et sans courir aucun risque. Cette manière de parler est suffisante pour un mathématicien. Mais vouloir affirmer absolument que le soleil est au centre de l’univers et tourne seulement sur son axe sans se déplacer de l’Est à l’Ouest, c’est une très dangereuse attitude qui est destinée non seulement à contrarier les philosophes scolastiques et les théologiens, mais aussi à porter atteinte à la sainte foi, en contredisant l’Écriture.13. »
Ce n’était donc pas le modèle héliocentrique14 en tant que théorie mathématique, qui gênait saint Robert Bellarmin – un des rares « docteurs de l’Église » de l’époque moderne15 – mais la prétention d’un savant isolé, au nom d’une thèse qu’il ne savait pas prouver16, d’obliger l’Église à reconsidérer l’interprétation traditionnelle de l’Écriture. Aucun conflit, donc, entre l’Église et la science, mais conflit provoqué par un mathématicien « véhément »17, inconscient des limites de la science et attribuant à tort au système copernicien une qualité de certitude qui n’a cours qu’en mathématiques pures, jamais en physique et moins encore en astrophysique.
Ce ne sont pas les consulteurs du procès de 1616 qui opposent la théologie à la science, mais Galilée lui-même qui croit pouvoir distinguer entre les doctrines simplement « opinables » (la théologie, objet de débats et controverses) et les doctrines « démonstratives » (l’astronomie, découlant immédiatement des faits par des raisonnements certains). Il écrit dans sa fameuse lettre à la grande-duchesse Christine de Lorraine :
« Je voudrais prier ces Pères très prudents de bien vouloir considérer avec diligence la différence qui existe entre les doctrines opinables et les doctrines démonstratives 18; pour cela, se représentant bien avec quelle force nous pressent les déductions nécessaires, ils se trouveraient plus à même de reconnaître pourquoi il n’est pas au pouvoir des professeurs de science démonstrative de changer les opinions à leur gré, présentant tantôt l’une tantôt l’autre ; il faut bien apercevoir toute la différence qui existe entre commander à un mathématicien ou à un philosophe, et donner des instructions à un marchand ou à un légiste. On ne peut changer les conclusions démontrées, concernant les choses de la nature et du ciel, avec la même facilité que les opinions relatives à ce qui est permis ou non dans un contrat, dans l’évaluation fiscale de la valeur d’un bien ou dans une opération de change19. »
Galilée va donc beaucoup plus loin que de défendre l’autonomie de la science, fondée sur un objet et une méthode propre. Il revendique l’indépendance absolue de ses conclusions ; il en nie la part d’interprétation ; il n’en soupçonne pas le caractère hypothético-déductif ; il ne songe pas à dissocier le fait d’observation et la théorie explicative. Et, fort de ces lacunes, il prétend renverser l’équilibre dans lequel se tenait le savant chrétien ayant devant lui les deux livres : le « grand livre de la nature » et la Bible.
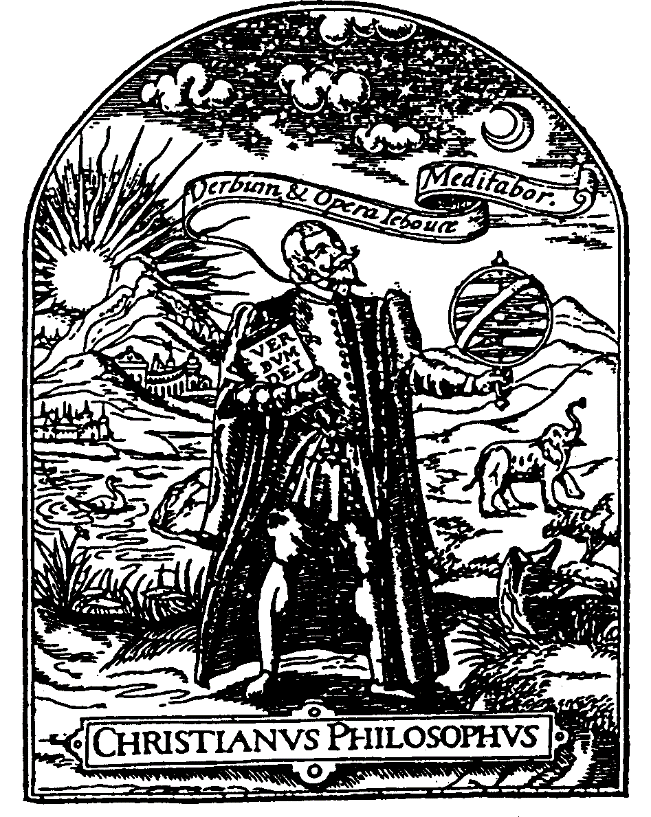
À l’exégète les incertitudes et approximations propres aux doctrines « opinables » ; au savant physicien la rigueur démonstrative et la certitude. Galilée revendiquait donc pour la seule science mathématisée une indépendance qu’il entendait refuser aux autres activités intellectuelles. C’était renverser la hiérarchie des savoirs, par méconnaissance d’imperfections et d’erreurs dans toute science humaine : « […] Les effets naturels et l’expérience des sens que nous avons devant les yeux, ainsi que les démonstrations nécessaires que nous en concluons, ne doivent d’aucune manière être révoqués en doute ni a fortiori condamnés au nom des passages de l’Écriture, quand bien même le sens littéral semblerait les contredire. Car les paroles de l’Écriture ne sont pas astreintes à des obligations aussi sévères20 que les effets de la nature et Dieu ne se révèle pas moins excellemment dans les effets de la nature que dans les écritures sacrées21. »
En d’autres termes, l’autorité de la science l’emporte sur celle de l’Écriture, car l’Écriture est, au fond, moins divine que la nature.
Ainsi la science finit par être plus divine que la théologie : elle nous fait accéder à Dieu directement, par une connaissance certaine de Ses œuvres, tandis que Sa parole, soumise à l’à-peu-près de la connaissance discursive, parfois mal interprétée par des commentateurs « plus attachés à leurs propres opinions qu’à la vérité »22 ne nous fait connaître, par elle-même, que des affirmations probables. Sous l’angle de la certitude, Galilée met ainsi la science au-dessus de la Bible. Il conserve l’argument d’autorité, en fait même un usage constant, mais il le confisque au profit de la science. Tel est le grand renversement qui justifie cette vénération dont les modernes ont toujours entouré Galilée.
Le drame est que l’Église, à reculons d’abord, puis désormais sans réticence, a fait siennes les prétentions de Galilée, abdiquant son autorité intellectuelle au profit de la « communauté scientifique », cette étrange fabrication médiatique qui a pour effet – sinon pour objectif – de permettre à un petit nombre de savants labellisés de parler au nom de la science et d’exercer ainsi le magistère socio-politique dont l’Église s’est dessaisie. « Ne pas contredire la science » est désormais, depuis plus d’un siècle23, le leitmotiv quotidien, paralysant et écartant de tout poste d’enseignement ceux qui, ayant conservé une once d’esprit critique, entendent remettre cette forme de connaissance à sa noble mais juste place au sein de la vision chrétienne du monde. Jusques à quand ?
1 Ch. VERDUNOY, Manuel d’Écriture Sainte, Dijon, Publications « Lumières », 1925, p. 12, souligné par nous.
2 Ibid., p. 9.
3 Ibid., p. 10.
4 Id.
5 Ibid., p. 9 (Il s’agit ici d’une citation implicite du Dictionnaire de la Bible).
6 Pour donner une idée des incertitudes admises concernant l’histoire égyptienne, il suffira de citer le « Que sais-je ?, 247 » sur L’Égypte ancienne par Jean Vercoutter (PUF, 12e édit. mise à jour 1987) : « Les XIIIe et XIVe dynasties ne sont connues que par les noms de leurs pharaons » (p. 70). « Après avoir eu tendance à croire très longue la deuxième période intermédiaire (1 583 ans si l’on additionne les chiffres donnés par Manéthon de la XIIIe à la XVIIe dynastie), on admet généralement aujourd’hui qu’elle ne dura pas plus de 200 ans et une théorie toute récente réduit encore ce chiffre » (p. 69).
7 Il existe cependant des indices stylistiques montrant que les récits des patriarches antédiluviens ont été conservés sur des tablettes. Cf. Claude EON, « La structure de la Genèse », in Le Cep n° 39, p. 65.
8 Se reporter aux commentaires de Wolfgang SMITH dans Le Cep n° 82 : « L’intrusion de l’idéologie en cosmologie » (p. 11).
9 On en trouvera la traduction française dans : Richard Von STERNBERG, « Pourquoi les catholiques ne doivent pas transiger avec la prétendue nature scientifique de la théorie de Darwin », in Le Cep n° 41, novembre 2007, p. 24.
10 Fondé en 1965, ce Conseil a fusionné en 1993 avec le Conseil pontifical pour la Culture.
11 Repentance : concept étranger à la civilisation chrétienne, fondée sur la responsabilité personnelle tant civile que morale, puisqu’il consiste à battre la coulpe des absents pour se ménager les faveurs de l’adversaire présent. On en chercherait en vain un exemple dans les évangiles.
12 Concile œcuménique Vatican II, Constitutions, décrets, déclarations, messages, Paris, éd. du Centurion, 1967, p. 253.
13 GALILÉE, Le opere di Galileo Galilei, Ed. Nazionale, t. XII, 1902, p. 171-172 (Trad. fr. reprise dans Giorgio de SANTILLANA, Le Procès de Galilée, Paris, 1955, p. 120).
14 Modèle, au demeurant, que nul ne songerait à soutenir aujourd’hui.
15 Il est curieux qu’il soit fêté le 13 mai, jour ouvrant le cycle des apparitions de Fatima, lesquelles devaient se clore avec la « danse du Soleil », 153 jours plus tard (153 étant notamment le triangulaire de 17 et le nombre des poissons de la pêche miraculeuse en Jn 21, 11).
16 Cf. J. de PONCHARRA, « Ptolémée, Oresme, Copernic, Brahe, Galilée, Kepler », in Le Cep n°56, p.21.
17 L’ambassadeur de Toscane à Rome, qui héberge et seconde Galilée dans ses démarches, Pierre Guicciardini, écrit au Grand-duc le 4 mars 1616 (en plein procès) : « Il est véhément et passionné dans son idée fixe, au point qu’il est difficile de lui échapper quand on le laisse approcher […] Il est évident qu’il est sous l’influence de la passion et qu’il ne peut, dans sa propre cause, juger sainement ce qu’il conviendrait de faire » (Pierre AUBANEL, Galilée et l’Église, Avignon, Aubanel, 1910, p. 67).
18 Souligné par nous.
19 François RUSSO, Galilée, aspects de sa vie, etc., Paris, 1968, p. 343.
20 Les divers travaux sur le « codage biblique » donnent un démenti flagrant à Galilée, car ils forment une vérification littérale – c’est le cas de le dire – à cette parole : « Jusqu’à ce que passent le ciel et la terre, pas un iota, pas un seul trait de la Loi ne passera que tout ne soit accompli » (Mt 5, 18).
21 RUSSO, op. cit., p. 337.
22 Ibid., p. 332.
23 On pourrait dire 111 ans. Dans le décret Lamentabili du 3 juillet 1907, PIE X condamnait encore solennellement l’erreur suivante : « Le dépôt de la foi ne concernant que des vérités révélées, il n’appartient sous aucun rapport à l’Église de porter un jugement sur les assertions des sciences humaines » (§5) (souligné par nous). A contrario, il en résulte que l’Église en général et les théologiens en particulier, peuvent avoir leur mot à dire, un mot spécifique compte tenu des lumières qui leur sont propres, sur les méthodes ou sur les conclusions de diverses disciplines scientifiques. Nous pensons forcément aux théories sur l’origine de l’homme et de l’univers, mais il en va de même dans bien d’autres domaines. Que l’on mesure par exemple la pauvreté de la psychologie universitaire, dressant le tableau d’un homme animalisé dans ses facultés inférieures et mutilé dans toutes ses facultés supérieures, face à l’anthropologie fine et subtile qui ressort de la Bible, des Pères et des Docteurs de l’Église.
