Partager la publication "La vision chrétienne du progrès"
Par Boulet André (père)
La vision chrétienne du progrès1
Résumé : Le transformisme opère la transposition dans le registre des êtres vivants du « mythe du Progrès » et en donne une sorte de justification par la science. Le progrès serait ainsi inscrit dans l’ordre des choses : une émouvante ascension de la vie depuis l’inorganique jusqu’à l’organique, du simple au complexe. Cette idée d’une évolution progressive de la Nature, inspirée du développement technologique, s’oppose à la vision chrétienne d’une Création initiale ex nihilo soumise à la Chute depuis le Péché originel. Le temps n’est pas alors un facteur positif par lui-même. L’espérance chrétienne s’élève au-dessus des contingences terrestres, mais suppose l’effort et le combat contre les puissances des ténèbres.
Certains transformistes spiritualistes vont jusqu’à affirmer qu’il y a une « infirmité de Dieu » devant le fait de créer : ce qui est appelé à l’existence par l’acte créateur est nécessairement marqué par la finitude, la souffrance et la mort.
Pour scandaleuse qu’elle soit, cette idée est en parfaite cohérence avec les postulats évolutionnistes sur lesquels se fonde la théologie qui la prend à son compte.
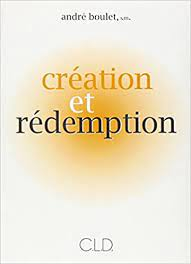
En raison du caractère particulièrement nocif de cette idée qui est une conséquence du transformisme, il nous apparaît opportun de pousser plus avant notre analyse et de mettre en évidence le fait que l’adoption du schéma transformiste, même sous sa forme spiritualiste, ne nous semble pas indifférent au regard de la foi chrétienne.
Une transposition et une justification du « mythe du progrès »
Le transformisme paraît bien être la transposition dans le registre de l’histoire des vivants du « mythe du progrès », et en quelque sorte sa justification : « La conception évolutionniste a envahi tous les champs de la connaissance humaine en se confondant avec le mythe du progrès » [Louis BOUNOURE, Déterminisme et Finalité, Paris, Flammarion, 1957, p. 80-81].
Combien d’auteurs se sont livrés à cet exercice de style fascinant qui consiste à décrire la lente montée de la vie, apparue sur terre il y a des centaines de millions d’années, par le jeu de forces physico-chimiques, et se manifestant d’abord sous une forme rudimentaire, puis déployant progressivement des formes de plus en plus complexes jusqu’à l’homme ! Ainsi la vie monte-t-elle irrésistiblement de l’inorganique à l’organique, du simple au complexe, de la gélatine primitive à l’homme. Cette lente « ascension » est bien l’équivalent d’une « marche en avant » dont on s’efforce de reconstituer la progression (le mot progrès vient du latin « pro-gressus », qui signifie « marche en avant »), l’imagination se portant volontiers au secours de la science défaillante.
Le « mythe du progrès » trouve ses origines dans la Philosophie des Lumières, au XVIIIe siècle. Le mouvement de l’esprit humain vers la connaissance est alors conçu comme une « marche en avant », un « progrès », une libération, une promesse de réussite et de bonheur. Le siècle des Lumières est persuadé que l’accroissement du savoir et du pouvoir sur les choses va suffire à rendre l’homme meilleur : le mal est identifié à l’ignorance, et l’acquisition du savoir au progrès humain. L’accumulation des connaissances scientifiques et techniques doit produire une mutation qualitative de l’esprit.
Les principaux penseurs du progrès au XIXe siècle vont chercher à en lire la loi dans l’ordre de la nature et de la vie. Pour Auguste Comte, par exemple, le progrès est le déploiement de l’ordre inscrit dans les choses, déploiement que la science positiviste reçoit mission de déchiffrer.
Pour Bergson, il est l’équivalent au niveau humain de ce qui se passe dans l’élan vital en général.
On comprend que, dans ce climat de « mystique du progrès », la thèse transformiste se soit comme naturellement épanouie. L’humanité semblait être parvenue au seuil d’un âge merveilleux, et un avenir radieux s’ouvrait devant elle : cet « âge d’or » que les générations précédentes situaient dans un lointain passé, et dont toutes les civilisations ont gardé un souvenir confus, était « à venir », projeté dans le futur, et source d’un optimisme qui nous semble aujourd’hui quelque peu utopique.
Le développement spectaculaire des connaissances scientifiques au XXe siècle (doublement des connaissances scientifiques tous les 20 ans) est venu conforter cette conception du progrès : toutes les questions, tous les problèmes pourraient être résolus par plus de science et de technique. L’idée de progrès était devenue idéologie.
L’idée de progrès devenue idéologie
On voit que ces conceptions font du progrès une sorte de nécessité historique ou cosmique. Le temps est considéré non plus seulement comme une échelle chronologique, mais aussi comme une échelle de valeur : il mesure tout autant qu’il génère le progrès. L’effort de l’homme conjugué aux effets du temps réalise un continuel développement dans un sens positif, du moins bien au mieux. L’idée de changement est chargée en elle-même d’une signification positive : du seul fait qu’il y a changement, il y a amélioration. Tout doit évoluer, puisque révolution (au sens très général du terme) garantit un mieux. Et la théorie synthétique de l’évolution devenait la pierre de touche de cette conception, sa caution scientifique, dans la mesure où elle offrait au mythe du progrès un fondement naturel et une illustration : la loi du progrès n’était-elle pas « inscrite dans les choses » ? N’est-il pas « naturel d’évoluer », comme l’affirmait récemment un thème de campagne publicitaire ? En somme, l’humanité progresserait vers son bonheur aussi nécessairement que la matière inerte a évolué vers le vivant et l’esprit.
Le progrès est en effet présenté dans la théorie synthétique de l’Évolution comme une complexification croissante des êtres vivants, au fur et à mesure que s’écoulent les ères géologiques.
À cet égard, il faut rappeler, comme l’a bien montre Michael Denton, que cette notion de complexification est tout à fait contestable du point de vue de la science : la notion de complexification ne trouve aucun appui objectif dans les observations scientifiques.
En d’autres termes, selon les mots de Giuseppe Sermonti : « Il n’y a pas eu transformation du simple au complexe. C’est là la révélation de la biologie moderne. La complexité biochimique d’un microbe n’est pas inférieure à celle d’une plante ou d’un animal2. » Les protozoaires les plus simples s’avèrent d’une grande complexité, parfaitement adaptés à leur milieu et capables d’opérations les plus élaborées. Le règne animal est caractérisé par des opérations supplémentaires par rapport au règne végétal. Mais en elle-même une nature végétale ou animale est parfaitement constituée. Dès lors, pourquoi un être vivant parfaitement adapté à son milieu devrait-il évoluer ? En vue de quelle amélioration ? Et par rapport à quoi un être peut-il être dit plus évolué qu’un autre ? Est-il meilleur d’être fougère que d’être algue, d’être girafe que d’être tourterelle, d’être gorille que d’être lémurien, d’être vipère que d’être brochet, d’être bœuf que d’être grenouille… ?
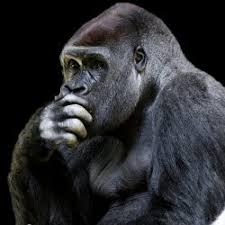
Tous les perfectionnements qu’un être vivant peut acquérir grâce à ses différentes opérations ne changent rien à sa nature : le jeune étalon devenu coursier reste un cheval, l’aiglon ayant appris à voler demeure un aigle, et l’enfant éduqué et cultivé n’a pas changé de nature humaine. Il semble bien que le transformisme raisonne comme si l’ensemble des êtres vivants ne constituait qu’un seul et même être vivant qui, en acquérant au cours du temps des opérations nouvelles, verrait sa nature se transformer, passant d’un type d’être considéré comme inférieur à un type supérieur, le stade ultime étant « l’hominisation ».
Non seulement il réalise un amalgame implicite entre les notions d’individu et d’espèce, mais il transpose au plan ontologique des constatations de fait qui ne sont qu’« accidentelles », c’est-à-dire n’affectant que certains caractères secondaires d’un être dont la nature est bien déterminée, ce qui peut provoquer des modifications apparentes de l’espèce au cours du temps, sans qu’il y ait pour autant passage insensible à une espèce différente.
La vraie mesure du progrès
La notion de progrès suppose un projet déterminé par rapport auquel les moyens mis en œuvre seront de mieux en mieux adaptés. L’observation commune montre que c’est bien par rapport à une finalité définie que peut se mesurer un progrès. Or chaque être vivant a, de par sa nature, sa propre finalité (même si celle-ci ne peut être exprimée) et son organisation est un ensemble d’opérations parfaitement adaptées à cette finalité, au point que le biologiste ne peut que s’étonner, s’émerveiller de l’ingéniosité omniprésente dans la nature, ce qu’en d’autres termes certains scientifiques appellent « l’énigme de la perfection », et ce qu’un regard simplement émerveillé devant la nature permet à chacun de percevoir. Les seules microévolutions effectivement constatées dans la nature vont à rebours de cette notion de progrès : elles sont soit limitatives, soit régressives, souvent létales ou amoindrissantes, bref sans « vertu évolutive » : monstruosité, acromégalie, morbidité, tels sont les seuls « progrès » apportés par l’Évolution, quand elle ne se limite pas à des caractères tout à fait secondaires, comme nous venons de le rappeler.

On voit que la conception évolutionniste du progrès des vivants est une sorte de projection dans le domaine des réalités naturelles de ce que l’homme peut réaliser dans le domaine technique.
Or si la technique humaine imite la nature, c’est pour en copier la perfection.
La théorie évolutionniste inverse ce rapport : la nature est sensée imiter l’homme dans ses réalisations de plus en plus « performantes ». Rappelons d’ailleurs que les extraordinaires « progrès » de la médecine n’ont en rien perfectionné le corps humain. Ils sont autant de moyens de remédier à un état défectueux, mais n’ont pas fait évoluer l’espèce humaine.
Le progrès est bien effectivement « réparateur » et non créateur. Toute l’histoire humaine peut être regardée comme l’effort de l’homme pour remédier à sa faiblesse naturelle.
On voit que tout autre est le progrès conçu comme un remède à des carences, et celui qui prétendrait être cause d’un changement dans la nature. Tout autre est la conception du progrès comme remède apporté à un défaut ou à un accident et celle qui voit dans le progrès un dynamisme interne inéluctable et créateur de nouveauté. Cette confusion semble être caractéristique du « mythe du progrès ». Mais, si l’homme doit constamment améliorer ses techniques, la nature n’en a guère besoin, et c’est bien illégitimement qu’elle a été invoquée pour accréditer le mythe du progrès : l’idée de progrès non seulement n’est pas confirmée, mais elle est contredite par bon nombre d’observations scientifiques. Or, soumis à la loi de l’Évolution, l’être vivant ne peut que difficilement être regardé comme s’inscrivant dans un ordre voulu par le Créateur. Réduit à l’état de maillon transitoire dans une longue chaîne se déroulant au fil du temps, il perd sa consistance propre. Soumis à la « loi des essais et des erreurs », la plupart des êtres vivants ne sont que des « brouillons » que la nature doit éliminer au profit d’êtres « plus perfectionnés », dont le sort ne sera guère plus enviable. Il est d’ailleurs curieux de constater que les reconstitutions d’animaux à partir de fossiles (reconstitutions en partie arbitraires, puisque le plus souvent les parties charnues sont absentes) présentent habituellement des êtres grossiers, aux formes inesthétiques ou menaçantes, auxquels sont attribuées des mœurs violentes : le monde préhistorique, étant « primitif », se doit d’être terrifiant et hostile, plus « sauvage » que celui que nous avons sous les yeux, puisque remonter dans le temps va de pair avec une régression.
Le langage de la Bible serait-il trompeur ?
Dans la perspective évolutionniste, chaque être vivant devient tout entier relatif au projet évolutif et en vient pour ainsi dire à se dissoudre dans un grandiose mouvement d’ensemble qui l’englobe, l’utilise, et le dépasse. Mais alors, comment continuer à affirmer, avec l’auteur inspiré du Livre de la Genèse, que Dieu a voulu positivement chaque être, chaque plante « selon son espèce », chaque animal « selon son espèce », qu’il a voulu chacun selon sa consistance, sa vérité et son excellence propre, dès l’instant où chacun n’est plus, au mieux, qu’un intermédiaire en voie de perfectionnement ou bien, au pire, la victime malheureuse d’une mutation défavorable ?
Le Créateur peut-il encore nous dire quelque chose de sa Beauté, de sa Sagesse, de sa Puissance, de sa Bonté, de son Mystère, à travers des êtres inconsistants, dont la plupart doivent disparaître pour laisser place à d’autres, eux-mêmes voués à un destin identique au nom de la loi implacable de l’Évolution ? Le langage de la Bible serait-il à ce point trompeur ? Ne nous invite-t-il pas à louer le Créateur pour chacune de ses créatures, chacune pouvant être admirée, contemplée pour elle-même, chacune s’inscrivant dans un ordre admirable ou tout est fait « avec nombre, poids et mesure » ? Si le dessein de Dieu était bien de créer en se servant de l’Évolution, comment expliquer que l’Écriture Sainte se prête si mal à cette interprétation, alors que l’idée d’Évolution est ancienne, et pouvait être comprise par les contemporains des rédacteurs du Livre de la Genèse ? Comment comprendre que tant de générations de lecteurs de la Bible aient été induites en erreur concernant une notion aussi importante que celle de leurs origines ? L’idée d’Évolution n’est-elle pas plus facile à comprendre que celle de Création, plus proche des raisonnements humains et de l’expérience « technique » de l’homme que celle de Création ex nihilo ?
Le temps dans la conception chrétienne de l’histoire
Nous avons montré que le « mythe du progrès », inhérent à la théorie transformiste, correspondait à une vision linéaire de l’histoire, dont le déroulement, comme guidé par une nécessité intrinsèque, acheminerait l’humanité vers un « âge d’or » situé dans l’avenir. Or, telle n’est pas la vision biblique de l’histoire. Celle-ci est en effet caractérisée par sa discontinuité : au commencement se situe « l’âge d’or » de la Création, temps mystérieux de la perfection originelle, dont le souvenir s’est conservé dans la mémoire de tous les peuples, temps brusquement interrompu par l’évènement historique de la « Chute » qui entraîne une série de dégradations dans l’univers livré au pouvoir de la mort. C’est par rapport à cette Chute, cette déchéance initiale, que peut être envisagé un progrès, progrès qui consiste essentiellement en une initiative de Dieu pour restaurer l’amitié perdue. La réponse de l’homme est marquée par l’inconstance, la fragilité, le péché, l’infidélité. Mais petit à petit, les alliances successives viennent restaurer en l’homme l’image de Dieu.
« À la plénitude des temps » se situe l’Incarnation, qui inaugure le temps de la « nouvelle Création » dans l’attente du retour glorieux du Christ à la fin des temps. Alors la Création sera rétablie dans sa perfection première, et toutes les créatures participeront à la louange du Dieu Créateur et Rédempteur [Apocalypse 5, 13]. Dans la conception chrétienne de l’histoire, le temps n’est pas par lui-même affecté d’une valeur positive : temps du péché et de la grâce, temps du combat spirituel, de l’affrontement avec les puissances des ténèbres, il est ambivalent. S’il acquiert une valeur positive, ce caractère relève de l’ordre de la grâce, et on ne peut parler de progrès véritable de l’humanité que dans l’ordre spirituel, sans que ce progrès soit pour autant un processus continu et linéaire, et sans qu’il se réalise nécessairement : c’est dans chaque liberté humaine que se joue l’histoire du Salut, et l’Espérance chrétienne est d’une tout autre nature que l’optimisme de l’utopie progressiste. Le retour du Christ à la fin des temps (la « Parousie ») n’est pas le terme d’un processus évolutif, l’achèvement naturel de l’Histoire, mais le décret insondable de l’amour du Père. Il inaugurera le renouvellement de toutes choses » dont parle Jésus dans l’Évangile.
1 P. André BOULET, s. m., Création et Rédemption, Paris, Éd. CLD, 1995, p. 124-129.
2 G. SERMONTI, R FONDI, Dopo Darwin, Milan, Rusconi, 1980, p.26.
