Partager la publication "Le cerveau, organe merveilleux et mystérieux"
Par Loron Philippe
Le cerveau, organe merveilleux et mystérieux1
Dr Philippe Loron2
Résumé : Depuis deux siècles, on connaît de mieux en mieux la localisation des fonctions cérébrales, la spécialisation (relative) des deux hémisphères et l’incroyable complexité des réseaux formés par les quelque 85 à 100 milliards de neurones qui véhiculent les signaux associés à nos pensées conscientes comme à notre fonctionnement réflexe, utilisant à la fois des processus électriques et chimiques. La maturation du corps calleux central, qui permet la connexion entre les deux hémisphères du cerveau humain, est étonnamment lente : 25 ans ! Et l’on sait depuis peu que, contrairement à une idée reçue, les neurones se reconstituent tout au long de notre vie. Mais le mystère de la pensée, du jugement ou de la créativité reste entier. Un électroencéphalogramme plat ne correspond pas nécessairement à la mort. Que de mystères à découvrir encore dans cet organe qui, par le développement du cortex, distingue radicalement l’homme de tous les animaux !
Le cerveau est un organe merveilleux, noble par excellence, mais mystérieux aussi. À l’aube du XXIe siècle, les scientifiques lui découvrent sans cesse des fonctionnalités nouvelles. Certes ils connaissent déjà les grandes lignes du métabolisme et des potentialités cérébrales, mais nous commençons à comprendre en plus le rôle de multiples neuromédiateurs et d’autres zones jusqu’alors inconnues. Le scanner, puis maintenant la résonance magnétique nucléaire apportent des données morphologiques anatomiques du cerveau que nous ne pouvions pas espérer avant. L’étude du débit sanguin cérébral, et celle du métabolisme par la caméra à positons, puis par la caméra à résonance magnétique fonctionnelle à ses débuts, établissent les relations entre l’anatomie et la physiologie (c’est à dire le fonctionnement) du cerveau chez l’homme.
À l’abri dans sa boîte crânienne, le cerveau est essentiellement composé de deux hémisphères cérébraux, le droit et le gauche, et d’une partie centrale profonde et médiane, appelée le diencéphale (comprenant notamment les noyaux gris centraux et l’hypothalamus qui sont des régions actives spécifiques) au-dessus du tronc cérébral (et du cervelet qui lui est apposé en arrière) qui le relie à la moelle épinière. Le système limbique (ensemble de structures nerveuses réparties en différents endroits mais représentant une unité de fonctionnement) qui mobilise les émotions et la mémoire se situe comme en interface entre le cortex (en surface) et l’hypothalamus et les régions voisines (en profondeur).
Jour et nuit, le cerveau travaille sans relâche à établir des relations entre le monde extérieur et nous-mêmes. Il reçoit des afférences sensorielles (ce qui entre) : vue, ouïe, goût, toucher, odorat, qui captent notre environnement. Il intègre ces données et les évalue tant sur le plan quantitatif (intensité) que qualitatif. Notre cerveau répond par les efférences (ce qui sort) : la pensée, la volonté, la motricité, les émotions, les idées, notre personnalité, le tout s’intégrant dans un ensemble comportemental. Notre cerveau est supérieur à un radar qui serait relié à un ordinateur de très grande puissance. Il est une structure biologique super sophistiquée vivant jour et nuit, de lui-même et par lui-même, en se nourrissant de rationalité et d’irrationalité.
Nous pouvons ici imaginer ce fonctionnement comme quelque chose de parfaitement biologique : donner et recevoir. Il faut comprendre les formidables potentialités qui sont en nous et accepter que la structure originelle du cerveau soit d’une richesse exceptionnelle. Toutefois les fruits récoltés seront en rapport avec la qualité des nourritures cérébrales. C’est ce qui fait entre autres la différence entre le fonctionnement cérébral des femmes et celui des hommes. Ainsi le cerveau est-il nourri de tout ce qu’il reçoit consciemment et inconsciemment de l’extérieur. Si ce qui le nourrit est positif, il y a des chances pour qu’il produise du positif. Dans le cas contraire, il peut produire du négatif, et en tout cas engendrer des conflits chez l’individu.
Les premières années de la vie vont conditionner ces fonctionnalités de façon importante, puisque apparemment vierge, il pourra imprimer des émotions et des potentialités du fait de son environnement.
Le comparer à un ordinateur n’est pas possible ; il est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe. Ce que l’homme a inventé n’est qu’un pâle reflet de l’ensemble extrêmement intégré de neurones (cellules nerveuses proprement dites) et de cellules gliales (cellules de soutien et d’apport nutritif), avec leurs diverses connexions. Certains psychologues disent que nous n’utilisons habituellement, c’est-à-dire dans nos conditions culturelles actuelles, qu’environ 10% de ces circuits intégrés (ce qui ne peut être démontré) – et il y a de 85 à 100 milliards de neurones. Pour preuve, il arrive que des neurologues découvrent encore des particularités nouvelles dans certaines régions du cerveau, jusqu’alors appelées « zones muettes », ceci plus particulièrement à la suite de lésions. Ces régions qui étaient « incomprises » auparavant, prennent parfois le relais de zones « détruites » ou apportent des potentialités nouvelles dans des situations particulières.
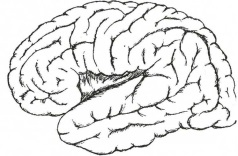
Fig. 1. Le cerveau est situé dans la boîte crânienne. Son aspect extérieur montre une apparence d’hémisphères, droit et gauche séparés par une scissure médiane peu profonde. Chaque hémisphère est grossièrement allongé et arrondi longitudinalement. Il présente en surface des sillons qui délimitent des circonvolutions. Ainsi, la surface active du cerveau est plus importante que ne le laisse supposer son volume réduit. Le schéma représente une vue de profil d’un hémisphère, l’avant étant orienté vers la gauche.
D’une façon générale (motricité, sensibilité, vue, audition), l’hémisphère gauche commande le fonctionnement de la moitié droite du corps, l’hémisphère droit commande le fonctionnement de la moitié gauche du corps.
Le constat des fonctionnements cérébraux intellectuels nous permet de considérer qu’au-delà des richesses originelles, qui sont en chaque homme sur la planète terre, nos origines culturelles, notre éducation et notre apprentissage de la vie nous amènent à travailler principalement avec certaines capacités cérébrales plus qu’avec d’autres. Ceci fait appel à la notion de latéralisation, ou encore de dominance cérébrale, ce qui s’appelle aussi de façon un peu réductrice, hémisphère droit – hémisphère gauche. Nous y retrouvons les valeurs de vie, les modes de consommation, les explications sur les évolutions sociologiques, les conséquences des pédagogies, les tendances du marché, les rapports humains, les méthodes de communication.
Cela peut vous paraître simpliste de tout rassembler au niveau du cerveau… et pourtant ! Les mots, les formes, les matières, les ambiances, les couleurs, les sons, les intonations, les phrases, les structures de phrases, les comportements, les gestes, les regards, font partie des nourritures de notre cerveau. C’est souvent de façon consciente ou non que l’ensemble de ces composantes nous font agir, réagir, construire ou détruire, rêver ou cauchemarder, être performant et créatif, ou perdant et en système d’opposition. De la sorte si vous comparez les comportements féminin et masculin, vous pourrez remarquer les différences dans les intonations, les couleurs, les gestes. Nous vous parlons bien sûr des femmes qui ne jouent pas à être des hommes, ou qui ne sont pas noyées dans le pouvoir, le savoir et la matérialité. Car il y en a, de ces femmes tueuses ou prédatrices, et il se pourrait qu’elles fonctionnent cérébralement comme les hommes, ou même pire, qu’elles dysfonctionnent. Mais regardons les vraies femmes, celles qui sont porteuses de vie, de charisme et d’espoir, et comme pour les hommes, sachons faire la distinction.
Droite, gauche, l’union sacrée !
À la différence des fonctions primaires (motricité, sensibilité, vue, audition), chaque hémisphère a sur le plan intellectuel ses fonctions spécifiques. C’est ce qu’on appelle l’asymétrie fonctionnelle.
Comme deux êtres dans un couple, comme deux individus autour d’un objectif connu qui remplissent chacun des rôles spécifiques sans se le dire à chaque instant. L’espèce humaine – du fait du langage qui lui est propre – est pourvue de ce qu’on appelle la latéralisation cérébrale. Il s’agit de considérer chaque hémisphère comme une entité à la fois particulière et interdépendante avec l’autre.
Ainsi l’entraînement à l’échange, au travail en commun entre les hémisphères par des pédagogies et un management approprié permet de développer des fonctionnalités complémentaires, nouvelles, bénéfiques pour l’individu et son environnement. Ce type d’échange ou de travail entre les deux hémisphères est de par une prédisposition anatomique et de par sa vie, plus naturel chez la femme que chez l’homme. Ainsi la latéralisation cérébrale serait plus équilibrée chez l’ensemble des femmes.
Pour comprendre cette répartition des fonctionnalités cérébrales, deux approches scientifiques complémentaires ont été nécessaires.
1- Les descriptions des lésions anatomiques par leurs conséquences en rapport avec des fonctions particulières : motrices, sensitives, sensorielles, de jugement, etc. C’est le fondement même de la pathologie et de la médecine. Lorsqu’on constate un déficit (paralysie d’un hémicorps, troubles sensitifs, amputation d’un champ de la vision), les corrélations avec la partie anatomique lésée permettent d’attribuer telle fonction à telle région du cerveau. Autrefois, il fallait attendre l’autopsie. Aujourd’hui, la stimulation électrique sous neurochirurgie, le scanner, la résonance magnétique et l’étude couplée du métabolisme et du débit sanguin cérébral permettent d’établir ces corrélations du vivant du sujet. Une cartographie du cerveau, telle une mosaïque imbriquée est ainsi possible. Nous connaissons désormais les aires motrices des lobes frontaux, les aires sensitives des pariétales, les aires visuelles des occipitales, auditives des temporales, les aires du langage, de l’appréciation de l’espace, des gestes symboliques, etc.
2 – Ce sont, il y a quelque 60 ans, les travaux de Roger Sperry et de ses collaborateurs sur les « split-brains » (patients à cerveau divisé), qui ont permis d’élucider le rôle respectif de chaque hémisphère dans les fonctions cognitives (dites supérieures ou intellectuelles), comme l’apprentissage, la mémoire ou l’adaptation. Il a reçu pour ces travaux le prix Nobel de Physiologie et Médecine en 1981. Grâce à Sperry, nous pouvons ainsi affiner les fonctions bilatérales. Nous sommes aux frontières de la neuropsychologie, bientôt peut-être dans le domaine de l’inconscient.
Droite, gauche… les fonctions intellectuelles se complètent sans s’opposer.
Au XIXe siècle, furent découverts avec Broca et Wernicke les centres du langage. Ils sont situés dans l’hémisphère gauche. L’un, antérieur, correspond aux sorties (expression orale et écrite). L’autre, postérieur, correspond aux entrées : il intègre le langage parlé et la lecture. De nombreuses études sont venues le confirmer. La base de la spécialisation de l’hémisphère gauche est bien réellement d’ordre linguistique. Le calcul est aussi géré à gauche. Les neurologues, du fait de l’importance du langage, attribuèrent très vite à cet hémisphère le terme de « dominant ». En corollaire, le droit était qualifié de « mineur ». De même, les gestes pratiques avec ou sans objets matériels relèvent plus de l’hémisphère gauche, ainsi que la distinction du côté droit par rapport au côté gauche.
En fait, chez les droitiers (environ 60 % de la population), l’hémisphère gauche est réputé dominant. Parce que les centres du langage, ainsi que celui du calcul y sont situés.
Chez les gauchers, les centres du langage sont souvent répartis entre les deux hémisphères, mais il existe quand même souvent une prépondérance pour l’hémisphère gauche. La dominance hémisphérique gauche est plus universelle pour le langage que pour la latéralité manuelle, puisqu’elle concerne tous les droitiers et environ 70 % des gauchers et ambidextres (soit en tout 95 % de la population selon Eccles3).
L’hémisphère droit apparaît être celui du « non verbal ». Il aurait tendance à capter le langage corporel ou inconscient pour une large part, bien qu’il puisse traiter le langage verbal dans une certaine mesure et surtout lors d’une déficience précoce du gauche. L’appréciation visuospatiale (relief, perspective, mémoire topographique), l’habillage, le dessin, la musique relèvent plus de l’hémisphère droit, surtout pour la conception des formes larges, vues dans leur ensemble, ainsi que la mélodie (et non pas à travers l’analyse du détail, qui concerne davantage le gauche). La reconnaissance des visages est aussi une de ses fonctions, ainsi que l’attention.
L’intuition sans doute et la confiance s’y rapportent probablement par un système de décodage inconscient. Ces fonctions bien « féminines » existent évidemment chez les hommes, mais pour des raisons que nous verrons plus loin, elles sont moins développées.
Parallèlement à ces constats, il est important de noter combien les fonctionnements des entreprises et de la vie économique et sociale sont en corrélation étroite avec nos fonctionnalités cérébrales. Cela permet de mieux comprendre aujourd’hui l’impact inconscient et les réactions plus ou moins prononcées des discours et des décisions politiques. Ainsi partant du principe que le cerveau doit recevoir des nourritures saines, vous imaginez sans peine les conséquences des comportements verbaux et non verbaux des technocrates et de certains élus !
Il en va de même des réactions à la publicité, à la consommation, l’acceptation ou non de certaines démarches marketing, l’attirance ou la répulsion pour certains hommes, pour des produits ou des messages.
Mais le cerveau n’est pas que « latéralisé » sur le plan des fonctions intellectuelles. Il existe des fonctions bilatérales qui obligent à une étroite collaboration symétrique des hémisphères selon un axe antéropostérieur.
Ces fonctions sont :
- la mémoire, dont le circuit est décrit surtout en ce qui concerne la rétention des faits récents. Il faut des lésions bilatérales pour constater des troubles mnésiques sur ce circuit ;
- l’orientation espace / temps (cependant plutôt hémisphérique droit) ;
- le jugement (lobes frontaux dans leur partie antérieure : les aires préfrontales) : l’initiative, la volonté seraient plus altérées en cas de lésions frontales bilatérales (surtout les aires motrices supplémentaires qui sont en avant des aires motrices élémentaires).
Une partie de la pensée serait donc redevable de cette localisation cérébrale, sans qu’on puisse la réduire à ces seules fonctions ou aux seules localisations frontales. Dans l’espèce humaine, les lobes frontaux sont très développés et concernent surtout l’élaboration de l’action programmée, et une forme d’apprentissage pratique, acquise par concentration attentive. Les émotions y seront exprimées également.
Ainsi pouvons-nous, en résumé, proposer un tableau de l’asymétrie fonctionnelle cérébrale :
Fig. 2 : Tableau des différentes fonctions hémisphériques réparties entre gauche et droit (d’après Eccles notamment) :
| Hémisphère cérébral | Gauche | Droit |
| Communication | Verbale | Non verbale Intonation affective |
| Stimulus principal | Langage et calcul | Images, formes, Géométrie, perspective, musique |
| Mode de fonctionnement | Analyse du détail Séquence linéaire (temps et logique) Idéation | Synthèse Appréhension globale des choses Analogie Sens des symboles |
| Conscience | individuelle | d’exister |
Signalons toutefois la créativité comme forme d’intelligence, fonction fort mal évaluée en neurologie, ou même en psychiatrie.C’est pourtant un attribut essentiel de l’homme : la création d’une vie, d’un foyer, la créativité professionnelle ou artistique, l’instinct créatif, la réactivité créative.
Nous nous attachons ici à mettre l’accent sur cette fonction, qui utilise harmonieusement les deux hémisphères, en intégrant à la fois l’imagination et l’efficacité pratique. La créativité est un des attributs les plus vitaux de l’être humain, c’est celui qui assure sa survie, son existence, sa croissance physique et mentale. La créativité couplée au savoir développe le sens de la connaissance des choses, de la compréhension des êtres et de la vie. Ce couple en complémentarité inspire une profonde conviction intérieure.
L’économie cérébrale : de subtiles interconnexions individuelles qui peuvent être extrapolées au monde économique.
L’hémisphère gauche avec les centres du langage, de l’écriture, du calcul logique, le lieu du raisonnement, pourrait être l’« hémicerveau » du quantitatif, de « l’avoir », avec une fonction d’analyse et une passion pour la rigueur et les procédures. Or nous devons constater que trop de gauche étouffe et risque d’entraîner des rapports de force et la violence, voire la destruction intérieure comme extérieure.
L’hémisphère droit est considéré plus « émotionnel ». Il est le siège de la formation de concepts non verbaux allant de la formulation mathématique à la composition musicale (notion de rythme exceptée, ce qui relève du gauche). Il est celui du « qualitatif », de l’intuition avec fonction de synthèse et concept de globalité. Il serait davantage l’hémisphère de l’imagination créatrice, sensible aux symboles et aux analogies imagées, et de la composition artistique. Trop de droit peut marginaliser et dévier.
L’idéal est l’équilibre harmonieux et construit. Or l’équilibre et l’idéal ne sont-ils pas une quête bien humaine qu’il faut sans cesse nourrir et construire ? Ces aspects de la vie ne sont-ils pas un long chemin ?
Mais attention aux schémas réducteurs et aux a priori tout faits. En réalité, sur le plan neurologique, dans la plupart des fonctions, les hémisphères agissent en coopération, en économie (du grec οἶκος oïkos, « maison » + νόμος nomos, « loi, règle », ensemble des éléments relatifs à l’administration et à la consommation des richesses) et en complémentarité. L’idée de dominance d’un hémisphère par rapport à l’autre réside dans les fonctions particulières que chacun utilise par rapport à ses ambitions personnelles et selon l’exploitation consciente de ses capacités cérébrales. Cependant, la plupart des activités humaines nécessitent en fait la coopération des deux hémisphères. Les échanges souhaitables peuvent être volontaires et calculés s’il y a entraînement et acceptation des talents, mais aussi automatiques et inconscients du fait de l’éducation. Les cultures occidentales ainsi que les fonctionnements sociaux prédisposent naturellement à une mobilisation du gauche aux dépens du droit.
L’analogie entre les fonctionnements intelligents de l’hémisphère gauche et de l’hémisphère droit avec la vie économique est donc aisée. Lorsqu’un financier rationnel s’associe avec un créateur intuitif… Lorsqu’un patron charismatique embauche une secrétaire rigoriste et analytique. Certains parlent de mésalliance, mais selon cette approche neuro-économique, cela représenterait plutôt une complémentarité ad hoc. Bien sûr, il faudra que cette union soit fondée sur le respect mutuel, l’acceptation et la complémentarité, l’humilité aussi. Elle sera alors source de richesses dans une situation d’échanges, de nourritures complémentaires et d’équilibre de fonctionnement.

Fig. 3.Les cellules unitaires du cerveau sont les neurones, ainsi que les cellules de soutien, ou cellules gliales. Les connexions entre 2 neurones sont des synapses (à gauche sur le schéma, une synapse agrandie) où la transmission s’effectue par des substances biochimiques, les neuromédiateurs (tels que acétylcholine, noradrénaline, dopamine et bien d’autres). Les neurones comportent un corps central avec le noyau, un prolongement principal ou axone qui transmet l’influx nerveux à conduction électrique (50 à 100 mètres par seconde) et des prolongements en arborescence ou dendrites qui reçoivent l’influx nerveux d’autres axones (quelque 10 000 connexions par cellule, celles-ci pouvant évoluer ou se modifier selon les besoins, d’où la grande plasticité du cerveau).
Le corps calleux pouvait être déjà compris à partir des observations en pathologie dès avant les années 60 : ce sont les syndromes dits de déconnexion calleuse (c‘est-à-dire par défaut de développement de cette structure ou par lésion cérébrale située à cet endroit).
Les travaux de Sperry, qui furent réalisés entre 1961 et 1981 à l’Institut de Technologie en Californie, ont contribué à faire connaître son rôle plus précisément.
Les techniques utilisées furent :
- expérimentation chez le chimpanzé (« split brain » ou section du corps calleux) ;
- commissurotomie (section des commissures, fibres reliant une structure à une autre, en l’occurrence ici section du corps calleux), et étude de tels patients dits « split-brain » (patients épileptiques rebelles à toute thérapeutique médicale, ou psychotiques graves).
La première eut lieu en 1962. Chez ces patients qui subirent ces interventions, les crises épileptiques se raréfient et diminuent en intensité, ou l’état psychotique s’amenuise. Il est alors rarement noté des gestes contradictoires entre la main droite et la main gauche indiquant une absence de collaboration des deux hémisphères. Le plus souvent il faut des circonstances particulières de laboratoire dans l’utilisation séparée des deux mains pour mettre en évidence cette moindre coordination entre les hémisphères (actuellement, cette intervention est pratiquement abandonnée).
Chez les patients « commissurotomisés », on aurait pu s’attendre à ce que chaque hémisphère se comportât de façon tout à fait indépendante. Mais ce ne fut pas le cas.
Malgré cette déconnexion majeure des deux hémisphères, il semble que le cerveau soit toujours capable d’assurer les activités propres à chaque hémisphère, avec un certain degré d’intégration et de coordination. Autrement dit, tout se passe comme si les sujets avaient un comportement normal, en dehors des épreuves particulières de laboratoire qui mettent leur déficience en évidence. Le corps calleux serait-il inutile, ou plutôt sous-utilisé ?
Comment expliquer ce paradoxe ?
La section du corps calleux n’interrompt que les fibres allant d’un hémisphère à l’autre dans la partie superficielle. Les échanges entre les deux hémisphères semblent alors continuer au niveau des structures cérébrales profondes.
Nous avons encore ici des ressources inconnues qui se mettent en contact dès que nécessaire. Ceci ressemblerait aux systèmes de communication formelle et informelle dans les organisations. Si le circuit direct est coupé du fait des informateurs (manageurs jouant de leur pouvoir par rétention d’information par exemple) les circuits indirects se mettent en place immédiatement. C’est « radio-moquette », ou « radio-potins » selon les expressions de chacun… Ces informations indirectes seront plus floues, moins utiles ou pratiques mais seront toujours une nourriture pour notre cerveau.
Au niveau cérébral, cette transmission « de secours » est cependant limitée à des informations peu élaborées, comme l’orientation de l’attention dans l’espace. Chaque hémisphère, dans ces circonstances, reste essentiellement non informé du fonctionnement élaboré de l’autre. Dans cette situation, l’habitude l’emporte sur la volonté de poursuivre sa croissance cérébrale. Ainsi le corps calleux apparaît-il indispensable au fonctionnement global de notre cerveau. Pourrait-on penser, avec toutes ces informations, qu’en situation normale, les échanges entre les deux hémisphères par le corps calleux ne soient pas, en général, développés au maximum chez les individus. Si l’on souhaite passer à une dimension supérieure et accéder à des potentialités cérébrales utiles et pratiques, nous devrons, comme pour assurer notre souplesse physique, pour entretenir notre corps, rester « jeune » sur le plan des neurones, nous exercer et exploiter cette pédagogie de la performance cérébrale.
La science nous apporte les preuves que certaines zones du cerveau entrent en maturation en fonction du temps, des époques de notre vie ou de nos besoins physiques ou intellectuels.
Une étude publiée dans la revue américaine, Annals of Neurology (juillet 1993), suggère que le corps calleux est la partie du cerveau qui met le plus de temps à arriver à maturation.
Aussi longtemps que la mentalisation s’épanouit chez l’homme, au moins jusqu’à l’âge de 25 ans, on observe une augmentation de sa taille, appréciée à l’imagerie par résonance magnétique (J. PUJOL & coll., étude effectuée à Barcelone). Dans ce constat physiologique, n’oublions pas que notre contexte occidental favorise la « musculation » de l’hémisphère gauche, ce qui pourrait freiner la mise en performance optimum du cortex et donc de nos capacités. Il faut garder en mémoire que la stimulation des connexions entre les deux hémisphères, que nous proposons par nos pédagogies, sont à même de développer les potentialités de votre cerveau. Il est nécessaire d’être prudent sur les méthodes et les textes que nous pouvons rencontrer régulièrement et qui prétendent faire travailler l’hémisphère droit, ou qui revendiquent plus de créativité ou d’intuition en opposition à un trop plein d’hémisphère gauche. Cette façon d’opérer risquerait d’être un nouveau déséquilibre. La performance mentale, la dynamique cérébrale telle que nous la vivons au quotidien, impliquent une mise en activité globale du cerveau.
C’est un travail d’échanges entre les deux hémisphères, et non un travail d’opposition comme le fait la pédagogie classique, l’économie, la politique et la gestion sociale habituelles. Notre pédagogie réalise un équilibre, des « retrouvailles » créatives, une alliance et un mariage du meilleur de chacun des hémisphères.
Une étude scientifique parue dans Neuro Report de mai 1995 confirmerait d’ailleurs notre approche neuro-économique à propos de la femme dans ses capacités à exploiter plus aisément que l’homme les échanges et les interactions entre l’hémisphère gauche et l’hémisphère droit. Elle semble, en effet, révéler que la femme disposerait en son cerveau d’un corps calleux naturellement plus développé que celui de l’homme.
Les effets en seraient les suivants : plus grande interconnexion des hémisphères et meilleure exploitation globale du cerveau. D’où la capacité à utiliser avec facilité, par exemple, l’intuition et la logique, la rationalité et la créativité, la confiance et le contrôle… L’intuition et l’analyse se compléteraient-elles donc ici avec grâce, tout comme l’esthétique et le rationnel qui lui conféreraient des capacités particulières ? Certainement, mais il serait trop réducteur de s’en arrêter à des schémas types, puisqu’en fait les interactions cérébrales sont impossibles à évaluer.
Tel un mouvement perpétuel, une fois les « réflexes » cérébraux acquis, sauf contexte défavorable, elles devraient demeurer et continuer d’apporter chaque jour leur lot de bénéfices vitaux. Est-ce pour cela que les femmes se plaignent souvent du manque de maturité ou d’évolution des hommes ? Est-ce également pour les mêmes raisons neurologiques que les femmes peuvent à la fois gérer leur maison, leur travail, l’éducation des enfants et le décor de la maison ? Faudrait-il d’autres constats pour que les hommes puissent croire en ces capacités ? Les découvrir, les accepter, les pratiquer, tout cela permettra aux mondes économique et politique et au plus grand nombre d’en tirer profit.
Après tous ces constats porteurs de résultats, nous en arrivons à évoquer l’approche neurophysiologique de l’inconscient. Ceci rapproche la neurologie de la psychologie pour laquelle nous savons que l’existence d’un inconscient n’est plus à démontrer.
Cela peut vous paraître étonnant d’expliquer l’inconscient, et pourtant !
En descendant dans les profondeurs du tronc cérébral, nous constatons que :
- L’éveil et l’attention sont subordonnés à une structure très en profondeur. Or c’est l’hémisphère droit qui est le plus en jeu pour gérer la réactivité et l’attention soutenue, ce qui permet de stimuler ensuite notre motivation. Une étude indique même que l’hémisphère gauche s’endort en premier ! Devons-nous alors penser que trop de travail sur l’hémisphère gauche nous endormirait et altérerait nos capacités ? L’alternance veille-sommeil est conditionnée par des rythmes neurobiologiques de certaines régions du tronc cérébral.
Or les circuits neuronaux semblent ici inter-réagir par système analogique, tel que la psychologie le rapporte pour le rôle des symboles, notamment dans les rêves et l’imagination provoquée.
- Les états dits « hypnoïdes » ou de conscience modifiée (proches du sommeil car le sujet reste éveillé), comme en relaxation, sophrologie ou méditation, offrent une moindre résistance du conscient et un fonctionnement positif de certaines dispositions comme la rationalité qui, en état normal ou de stress, auront tendance à être négatives, et conduisent à une plus grande ouverture à l’inconscient, d’après les pratiques psychothérapeutiques actuelles (je signale les travaux du psychologue Allan Schore en Californie, qui avance que l’hémisphère droit est dominant en ce qui les concerne). Ces états sont caractérisés par une déconnexion partielle des stimuli extérieurs, avec possibilité d’une meilleure concentration intérieure. La respiration est plus lente : des modifications des paramètres physiologiques ont lieu et sont le reflet d’une interaction en profondeur. Ils favorisent la créativité et le recours aux symboles. Est-ce donc un réveil de l’hémisphère droit et un « endormissement » du gauche, ou bien l’activation de plus grands échanges qualitatifs entre les deux ? Il semblerait que cette dernière hypothèse soit à retenir.
Signalons pour notre propos l’ouvrage du cancérologue et Professeur Lucien Israël (Cerveau droit, Cerveau gauche. Cultures et civilisation, Paris, Plon, 1995). Il confirme en tous points ce que notre travail et nos méthodes apportent à nos clients depuis plus de 30 ans.
Il est vrai que notre originalité est de réaliser des actions pratiques en entreprises ou pour des particuliers, ce qui nous permet, outre des résultats, une certaine expérience démontrable. Comme par nous, cet ouvrage souligne de façon pertinente l’aspect « cerveau droit ».
Ainsi la science en est-elle venue, à l’aide de nombreuses études psychologiques complémentaires, à proposer des modes de fonctionnement, des capacités différentes pour les hémisphères gauche et droit.
Mais le constat ne suffît plus à l’heure actuelle et il nous semble indispensable de passer à l’action de façon pragmatique et mesurée.
Notre culture y est pour beaucoup dans nos modes de fonctionnement actuels, comme le confirment bien des ouvrages, (par exemple, celui de J.-L. Juan de Mendoza, Un cerveau – Deux Hémisphères, coll. « Dominos », Paris, Flammarion, 1995 ; ou encore, parmi tant d’autres, ceux qui évoquent entre 1996 et 2016 cette ouverture culturelle sous le terme de « révolution du cerveau » en anglais : de Marilyn Ferguson au Dr Evian Gordon).
Même si l’homme est naturellement prédisposé à la large utilisation du langage pour communiquer, le contexte rationaliste et la culture écrite, surtout en Occident, a parfaitement privilégié un comportement cérébral intellectuel gauche avec les conséquences que cela suppose comme nous le voyons sur le plan vital et économique.
Combien de temps prendra cette prise de conscience, comment faudra-t-il informer et enseigner cette nouvelle compréhension de l’individu et de la vie ? Nous allons sans doute revivre les résistances et les querelles de « chapelles », les refus ou les engagements à 300 %.
À moins… que chacun d’entre nous ait l’humilité de regarder, d’écouter, d’essayer… d’accepter et de s’accepter.
Face à ce déséquilibre, il est souhaitable de retrouver l’harmonie, par l’unification des potentialités dans le sens d’une complémentarité épanouissante, et non d’une opposition comme le monde économique nous l’offre bien trop souvent avec des certitudes savantes reposant sur des raisons rationnelles.
Le cerveau… on n’a pas fait mieux depuis la création de l’homme !
Les neurosciences ont pour effet de rapprocher le domaine du cerveau, objectif, et celui de la psychologie, subjectif. Or, les notions de quantitatif et de qualitatif ne s’excluent pas. Derrière la fausse apparence de « dominance » hémisphérique gauche se profile ce qui relève de l’être, de la vie profonde, voire de la foi. Certains n’ont-ils pas écrit que l’hémisphère droit serait concerné par la spiritualité ? En tout cas, au-delà de ces décryptages physiologiques du cerveau – allant jusqu’à mettre en évidence la dignité intrinsèque de tout être humain, doté d’une créativité qui reste, hélas, trop souvent enfouie, capable d’être « co-créateur » en vue du Bien commun –, la merveille qu’est notre cerveau laisse entrevoir cette plus grande merveille que représente notre conscience avec son libre-arbitre ainsi que sa capacité d’aimer et d’être aimé, voire d’adorer son Créateur…
1 Repris et actualisé de Philippe LORON & Didier REINACH, Les Fabuleuses Richesses économiques du cerveau, Paris, Ed. du Dauphin, 1998, 154 p.
2 Neurologue, ancien chef de clinique à La Salpêtrière, le Dr Ph. LORON est l’auteur de La Révélation cérébrale, 2022, 17€.
3 Sir John ECCLES, neurologue d’origine australienne, reçut en 1964 le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur les connexions entre neurones. Il est notamment l’auteur d’un livre majeur, traduit en français sous le titre : Évolution du cerveau et Création de la conscience (Fayard, 1992), Paris, Flammarion, 1994. Sa conception de la conscience le classe dans le courant non matérialiste.
