Partager la publication "La dette et l’effondrement de l’antiquité"
Par Hudson Michaël
La dette et l’effondrement de l’Antiquité1
Michael HUDSON2
Résumé : Professeur d’économie à l’Université du Missouri, Michael Hudson a depuis longtemps critiqué l’économie financiarisée actuelle et les dérives où a mené ce capitalisme dont les économistes classiques faisaient une panacée, y voyant même le moyen de supprimer les guerres. Dans son tout dernier livre, paru cettee année, L’Effondrement de l’Antiquité, il nous amène à relire l’histoire à la lumière du traitement politique de l’endettement des particuliers. Dans le Code d’Hammourabi, à Babylone, comme dans le Lévitique, une limite de temps était fixée à l’endettement : tous les 50 ans, le débiteur asservi retrouvait sa terre et sa liberté. Jésus-Christ fait allusion à cette remise des dettes dans le Notre Père. En revanche, la Grèce à partir du Ve siècle avant Jésus-Christ, puis Rome, furent des sociétés esclavagistes, réservant la citoyenneté à une petite minorité. On pourra trouver réductrice cette lecture économique influencée par Marx, et donc matérialiste, de l’Histoire, mais la force de la démonstration est ici amplifiée par la comparaison avec l’actuel fonctionnement des États-Unis, où une tonitruante démocratie agit en réalité comme une oligarchie financière pour laquelle le bien commun n’est pas l’objectif. Ce sera aussi l’occasion d’éviter l’admiration béate d’une Antiquité qui comprit très vite pourquoi (ou plutôt pour qui) le christianisme représentait un danger.
Colin Bruce Anthes – Bienvenue dans L’Analyse. Je suis Colin Bruce Anthes. Nous allons aujourd’hui jeter un premier coup d’œil sur le nouveau livre de Michael Hudson : L’Effondrement de l’Antiquité3.
Michael Hudson – Lorsque les empereurs romains annulèrent les dettes, il s’agissait en grande partie d’annuler les dettes des riches. Un peu comme les récents renflouements bancaires de la Silicon Valley Bank et des banques aux États-Unis. Les riches n’ont pas à payer les dettes, mais si vous n’êtes pas des leurs, vous devez payer vos dettes. C’est le principe de base, et c’est ce que l’Amérique appelle la démocratie.
C. A. – Le Dr Michael Hudson apporte depuis longtemps de la clarté historique à l’économie politique. Dans ses livres comme Killing the Host (2015) et J Is for Junk Economics (2017), il a montré comment les économistes néoclassiques ont transformé les termes de l’économie politique en leurs contraires, créant des marchés libres pour les rentiers plutôt que libérés d’eux-mêmes. Ses recherches sur les premières pratiques de création et d’annulation des dettes ont été au cœur du succès fulgurant du livre de David Graeber, Debt : The First 5 000 Years (2011).
Le Dr Hudson vient de publier un nouveau livre intitulé L’Effondrement de l’Antiquité, examinant comment les pratiques devenues problématiques dans l’ancien Empire grec, puis accélérées dans l’ancien Empire romain, ont conduit cet Empire à se transformer en un État rentier et à s’effondrer de l’intérieur. C’est une trajectoire fascinante qui passe par les anciens philosophes et réformateurs grecs, l’assassinat de Jules César, la montée de Jésus, l’inversion du christianisme et la réécriture du Notre Père. Mais le Dr Hudson ne se contente pas de donner un compte rendu historique, il s’attaque également à une tendance inquiétante parmi les économistes contemporains, consistant à contourner l’histoire de la lutte entre créanciers et débiteurs, suivant ainsi les néoclassiques, alors que les mêmes problèmes s’accélèrent aujourd’hui.
J’ai pensé qu’une bonne façon de commencer serait de jeter un œil sur quelques citations que vous donnez dans votre livre, une de Cicéron et une de Plutarque.
Cicéron était très opposé à l’annulation de la dette et Plutarque très opposé à ceux qui recouvraient les dettes. Je vous demanderai de commenter de quelle manière cette tendance se répercute à travers les âges. Voyons d’abord Cicéron :
« Les hommes qui administrent les affaires publiques doivent d’abord veiller à ce que chacun garde ce qui lui appartient et que les particuliers ne soient jamais privés de leurs biens par des actes publics, car les communautés politiques et les citoyennetés ont été constituées spécialement pour que les hommes puissent continuer à détenir ce qui leur appartenait. »
Cela ressemble beaucoup au discours de l’establishment politique d’aujourd’hui. Voici maintenant ce qu’en dit Plutarque :
« La cupidité des créanciers ne leur apporte ni plaisir ni profit et ruine ceux à qui ils font du tort. Ils ne cultivent pas les champs qu’ils prennent à leurs débiteurs, ni ne vivent dans leurs maisons après les en avoir expulsés. »
Voulez-vous nous dire comment ces citations reflètent une bataille qui dure depuis plusieurs milliers d’années ?
M. H. – Rome a légué à l’Occident un Droit axé sur les créanciers, en protégeant vraiment les créances financières de l’oligarchie, les 1%, au lieu de protéger l’économie dans son ensemble, laquelle est très largement composée de débiteurs. Ainsi, lorsque vous dites que vous soutenez les droits des créanciers, cela signifie leurs droits de priver le reste de l’économie, les débiteurs, de leur liberté. On vante cela aujourd’hui comme s’il s’agissait d’individualisme. Mais l’individualisme, du moins à la romaine, n’est pas égalitaire ; il est oligarchique. L’idée romaine de liberté était le privilège pour l’oligarchie d’endetter, d’exproprier et de priver le gros de la population de sa liberté, de ses moyens de subsistance, de son accès à la terre. C’est ce qui a rendu l’Antiquité classique si différente des 3 000 ans qui s’étaient écoulés auparavant, dans l’ancien Proche-Orient où était pratiquée l’annulation de la dette.
Alors les dirigeants rétablissaient l’accès à la terre, annulaient les dettes et libéraient les esclaves pour dette. Au moment où la Grèce et Rome se développaient, du VIIe au Ier siècle avant J.-C., et même dans la Babylonie de l’époque, vous aviez très peu de servitude pour dettes.
Il y avait des esclaves, en grande partie des filles qui étaient capturées dans les montagnes : le mot sumérien et babylonien pour « esclave » est « fille de la montagne », mais vous n’aviez pas de débiteurs, de citoyens tombant en servitude pour leurs dettes, de façon irréversible.
Ce que fit Rome fut de rendre irréversible et permanente cette perte de liberté, cette dépendance, cette servitude. Tel est vraiment ce qui a rendu la civilisation occidentale différente de tout ce qui l’avait précédée, et nous sommes toujours sur cette lancée.
C. A. – Maisrevenons un peusur les dirigeants sumériens et babyloniens qui remettaient régulièrement la dette ! Il y eut même des tentatives de systématisation de cette pratique dont nous avons les archives.
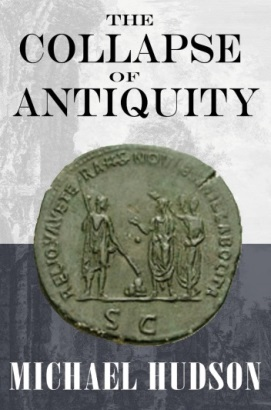
Fig. 1 : Le dernier livre de Michael HUDSON : L’Effondrement de l’Antiquité.
M. H. – En fait, l’année du jubilé en Lévitique 25 correspond mot pour mot à l’annulation des dettes que la dynastie d’Hammourabi avait codifiée au début du IIe millénaire avant notre ère. C’était chose normale pour les dirigeants sumériens, babyloniens et même assyriens du VIIe siècle avant J.-C. À peu près au moment où le commerce fut relancé avec la Grèce et l’Italie, même eux annulaient les dettes, libéraient les esclaves et restituaient les terres qui avaient été remises aux créanciers. Les dirigeants voyaient que s’ils ne proclamaient pas cette annulation de la dette, en rétablissant des relations économiques normales, alors les débiteurs devraient leur travail aux créanciers. Ils devraient travailler la terre des créanciers et sur leurs domaines et, à la fin, leur abandonneraient leur terre.
Alors, ils ne pourraient pas travailler à des projets d’infrastructure en faisant la corvée ; ils ne pourraient pas non plus servir dans l’armée. Il fallait donc restaurer les droits normaux de citoyenneté. Ces droits, avant la Grèce et Rome, comprenaient un accès garanti à la terre et à l’autosuffisance.
Pour le dire dans les termes de Karl Polanyi, la terre n’était pas marchandisée, ni le travail. L’argent et la dette n’étaient pas marchandisés au-delà d’un transfert temporaire. Le Proche-Orient avait connu un renouveau et une croissance économiques continus. Rome et la Grèce stoppèrent ce processus de progrès économique, et une part croissante de la population tomba en servitude. L’économie s’est alors polarisée et le résultat fut l’Empire romain. Nous savons tous où cela a mené.
C. A. – Vous dites qu’il y a cet élément d’équité citoyenne qui entre dans l’annulation de la dette, mais aussi du pur pragmatisme. L’économie réelle ne peut donc prospérer sans ces périodes où la question de la dette est réglée.
M. H. – Oui, c’est exactement cela. L’idéologie moderne pense qu’il existe une démocratie occidentale – jadis en Grèce, à Rome et aujourd’hui aux États-Unis – face à d’autres pays que l’on appelle des autocraties, c’est-à-dire dirigés par un seul. La royauté avait une vertu dans l’ancien Proche-Orient : elle pouvait empêcher qu’une oligarchie domestique ne se développât.
Lorsque la Grèce et Rome s’ouvrirent au commerce, au VIIIe siècle avant J.-C., elles eurent des chefs, mais plus de dirigeants indépendants. Il n’y eut alors ni palais ni temples indépendants. Les chefs devinrent des oligarques, essentiellement par l’absence de contrôle externe sur leur agrandissement. Très vite, à la fois en Grèce et dans les villes italiennes, on vit s’instaurer des cités-États locales de type mafieux. En Italie, la situation devint telle que beaucoup de gens s’enfuirent ; ils ne voulaient pas qu’un État de type mafieux prît le pouvoir, et beaucoup d’entre eux allèrent à Rome, parce que la Ville voulait attirer des immigrants. La main-d’œuvre demeura le facteur économique limitant la croissance aux VIIIe, VIIe et VIe siècles avant J.-C. Tout le monde voulait des travailleurs. Afin d’attirer la main-d’œuvre sur votre terre, vous deviez lui donner un certain degré de liberté, non la servitude.
En Grèce, des réformateurs renversèrent les États mafieux et furent appelés « tyrans ». À l’origine « tyran » n’était pas un mot péjoratif [du grec ancien τύραννος turannos « maître absolu »]. Il fut, je pense, repris des Perses et signifiait simplement la personne qui contrôlait. Les hommes au pouvoir, les soi-disant tyrans, ont ouvert la voie à la démocratie en annulant les dettes et en redistribuant la terre. Tel fut le rôle essentiel des tyrans, et à Rome des premiers rois, selon les historiens. Ils soutinrent les débiteurs, autrement dit la population en général. Ils ne voulaient pas d’une prise de contrôle par un petit groupe de personnes.
C. A. – C’est très intéressant, parce que la signification du terme « tyran » a pris une connotation très négative. Mais en réalité, il est question de gens s’appuyant sur la population et qui pouvaient donc contester le système.
M. H. – Les mot rappellent notre situation d’aujourd’hui. Lorsque le président Biden dit que le monde se divisera dans les vingt prochaines années entre démocraties et autocraties, ce qu’il entend par démocratie est ce qu’Aristote appelait l’oligarchie. Le Philosophe disait que les démocraties se transforment en oligarchies. Donc Biden dit en réalité qu’il s’agit de l’oligarchie contre l’autocratie. Ce qu’il entend par autocratie est ce que les Romains entendaient par royauté, et les Grecs par tyrannie. Cela signifie un gouvernement fort, assez fort pour empêcher qu’une oligarchie créancière émerge et s’empare de la terre, s’approprie l’économie et la réduise au servage. Il faut une économie mixte. Il faut un secteur public et un secteur privé pour qu’ils agissent de concert. Le rôle du gouvernement est d’empêcher le secteur privé de polariser la société de manière à lui impose l’austérité. Or c’est exactement ici que la rhétorique grecque et romaine a servi contre la royauté et la tyrannie. Tel est bien ce que l’on retrouve aujourd’hui dans les discours du Département d’État américain.
C. A. – Mais revenons à Rome et voyons comment le Sénat fut créé : c’était foncièrement une dictature de classe.
M. H. – Oui, le vote était pondéré en fonction de la richesse et de la terre possédées et, plus tard, de la seule richesse. Les votants étaient répartis par groupes de richesse. Les classes les plus riches, peu nombreuses, reçurent un poids électoral si lourd que ces trois ou quatre classes – entre 1 et 3% de la population – pouvaient surpasser l’ensemble.
Aujourd’hui, nous le faisons par les contributions de campagne. Nous avons nous aussi privatisé le système électoral, mais sans que les votes des riches comptent plus que les autres. Nous laissons simplement les gens riches donner plus d’argent que n’importe qui d’autre pour la campagne électorale. Nous faisons donc de notre mieux pour imiter la Constitution romaine.
C. A. – Mais revenons sur la montée des tyrans. Vous dites que la dette portant intérêt ne s’est vraiment implantée en Grèce que vers le VIIIe siècle av. J.-C. Ensuite, arrive cette série de tyrans qui défient continuellement le système. Leurs réformes étaient presque toujours centrées au moins sur une certaine forme d’annulation de la dette et de redistribution des terres.
M. H. – Et c’est exactement le programme que le Jubilé appliquait chez les Hébreux. Vous pouvez alors imaginer le problème de la civilisation moderne et de Rome. Une fois que Constantin eut fait du christianisme la religion romaine officielle, comment allait-il agir avec la remise des dettes dont parlait Jésus dans son premier sermon [Lc 4, 19] ? Car il avait dit être venu pour remettre les dettes, donc pour restaurer l’année du Jubilé.
C. A. – Tous ces points vont se rejoindre. Ce fut d’abord, comme vous l’écrivez dans ce livre, la poussée vers ce que nous appelons aujourd’hui tyrannie, car les termes ont changé au fil du temps, donc vers le contraire de la démocratie. Telle fut la force motrice vers le développement des systèmes « démocratiques » dans la Grèce antique.
M. H. – La question est : qu’est-ce que la démocratie ? Aristote a avancé cette idée qu’il y avait éternellement un flux circulaire et triangulaire. Il a dit qu’à l’origine, les gens étaient sous l’autocratie, puis certaines familles riches ont émergé, donnant une première aristocratie, comme ce fut le cas dans les premières cités-États grecques. Ils ont su attirer les gens dans leur camp, comme le fit Clisthène à Athènes en 506 av. J.-C. Ensuite, ils établirent la démocratie. Mais, au sein d’une démocratie, certains s’enrichissent plus que d’autres, et la démocratie devient une oligarchie. Aristote dit qu’il existe de nombreuses Constitutions qui se disent démocratiques mais qui sont en réalité oligarchiques. Il n’a pas mentionné la Constitution américaine parce qu’elle n’était pas encore écrite, mais je pense que le même principe s’y applique.
Alors l’oligarchie devient héréditaire et se mue en aristocratie. La vie se polarise jusqu’à ce que certains membres de l’aristocratie héréditaire finissent par dire : nous tuons toute l’économie, et nous ne pourrons jamais combattre et gagner des guerres si nous ne nous ouvrons pas aux Lumières. Ils font alors une révolution démocratique et restaurent la démocratie. Vous retrouvez ce même cycle encore et encore. Telle était sa vision de l’histoire.
C. A. – Avec les anciens philosophes grecs, nous voyons ces avertissements d’Aristote et ses préoccupations concernant la démocratie et l’oligarchie, et nous voyons aussi Platon et sa République. Il y prendSocrate comme son porte-parole, mais peut-être s’agissait-il vraiment des vues de Socrate. Ces gens n’étaient pas nécessairement des révolutionnaires. Ils étaient affiliés aux classes aristocratiques elles-mêmes à bien des égards. Mais ils voyaient dans la poursuite d’une dépendance envers la richesse le principal agent corrupteur et destructeur de la société.
M. H. – C’est exact. Tel était le dénominateur commun aux pièces d’Aristophane, aux discours de Socrate et aux Dialogues de Platon. C’était bien ce qu’il fallait faire : dire que la cupidité est mauvaise et que nous ne voulons pas que la richesse nous rende dépendants comme une drogue. Pourtant, c’était bien le cas. Il y avait une hypocrisie fondamentale dans l’idéologie de la classe dirigeante : très égalitaire en son sein, mais tous « accros » à la richesse. Donc la théorie économique était beaucoup plus sophistiquée dans l’Antiquité qu’aujourd’hui.
Tous les modèles économiques actuels supposent une utilité marginale décroissante. Si vous mangez une banane, vous apprécierez moins la banane suivante. Lorsque vous mangerez votre dixième banane d’affilée, vous en aurez vraiment assez des bananes ! Donc plus vous en avez, moins vous en voulez.
C. A. – N’est-ce donc pas le cas ?
M. H. – Ce qu’Aristote et Aristophane disent, c’est que la richesse crée une dépendance. Il en faut toujours plus. Dans les pièces d’Aristophane, et je les cite dans mon livre, plus vous avez d’argent, plus vous en voulez. L’argent crée une dépendance, contrairement à la nourriture et à d’autres biens. Or cette dépendance à la richesse ne joue aucun rôle dans la théorie de l’utilité qui est enseignée aux étudiants en économie en tant que prémisse de base sur laquelle reposent les modèles économiques.
On n’imagine pas que des gens opulents puissent essayer de prendre le contrôle de l’économie par égoïsme croissant.
Même avant Aristote, les Babyloniens avaient un modèle mathématique qui était de loin supérieur à tout modèle mathématique utilisé n’importe où aux États-Unis ou dans le monde occidental. C’était un modèle très simple, et nous savons ce qu’il en est parce que nous avons les manuels que les scribes utilisaient vers 1800 av. J.-C. Le premier exercice mathématique des scribes babyloniens était le suivant : combien de temps faut-il pour qu’une dette double ? Toute dette (dette portant intérêt) a un temps de doublement. Ils ont vu qu’il s’agissait d’une croissance exponentielle : doubler, doubler, doubler, doubler, pour une certaine unité de temps.
Ils avaient aussi leurs méthodes pour calculer la croissance d’un troupeau, ce qui était une bonne approximation de l’économie. La croissance d’un troupeau se traduit par une courbe en S tout comme aujourd’hui4. Ainsi, ce que les Babyloniens avaient compris et que tout le Proche-Orient avait compris, c’est que les mathématiques de la dette sont différentes des mathématiques qui décrivent l’économie de la production et de la consommation. La dette croît de façon exponentielle et inexorable au-delà des capacités de croissance de l’économie réelle. Le travail d’un dirigeant est de rétablir l’ordre en ramenant les dettes à la capacité de les payer. Rien de tel ne s’est produit en Grèce et à Rome. Quand les gens ne pouvaient pas payer, ils perdaient leur terre et leur liberté. Ils devenaient esclaves de leurs créanciers. C’est ce qui rendit la civilisation occidentale si différente du monde préexistant.
C. A. – C’est absolument fascinant : il ne s’agit pas seulement de dire que la dette a un caractère problématique ou qu’il peut y avoir une crise ; en fait, il faut admettre qu’il s’agit d’un problème récurrent. La dette va ronger l’économie réelle si nous n’intervenons pas régulièrement.
M. H. – Exactement !
C. A. – Mais j’aimerais approfondir ce dont parlait Platon avec Socrate. Le personnage de Socrate, dans la République, est très opposé à la démocratie à certains égards. Il y voit une sorte de pente glissante. Mais il croit qu’au fond, il faut trouver des politiciens qui soient en quelque sorte imperméables à l’argent, se contentant d’un revenu de base et vivant hors d’un monde où il s’agit d’accumuler de la richesse.
M. H. – Tout le cadre de la République de Platon a été déformé. Je suis allé à l’Université de Chicago pour le premier cycle. Mon cours préféré était « Organisations, méthodes et principes de la connaissance » (OMP), et nous avons tous dû étudier la République. J’avais environ 17 ans à l’époque, et, dans le discours ambiant, on considérait que Socrate parlait d’un roi noble, d’un despotisme noble, ou de ses guides. Or c’est là une déformation de ce que disait Socrate.
Au tout début de la République, Socrate interroge : « Devez-vous rembourser les dettes que vous avez à l’égard d’autrui ? » Puis il dit : « Que se passe-t-il si quelqu’un emprunte une arme à une personne méchante et agressive ? Doit-on rendre son épée ou son arme à cette personne qui l’a prêtée ? Si vous le faites, comme c’est une personne violente, elle va peut-être se servir de l’arme pour faire le mal. Est-il vraiment juste de la restituer ? L’interlocuteur répond que non. Alors Socrate dit : « Que se passe-t-il si vous lui empruntez de l’argent, si vous lui payez votre dette, et s’il utilise cette dette comme une personne égoïste et violente utiliserait une arme ? Il se sert de la dette pour vous enlever votre liberté, pour vous enlever votre terre, donc pour faire de vous ce qu’il ferait avec une arme. Il y a eu beaucoup d’assassinats politiques, n’est-ce pas ? L’élève ne sachant plus quoi répondre, Socrate enchaîne : « Voici le problème. La plupart des dirigeants aujourd’hui sont des créanciers. Les dirigeants, les politiciens qui sont élus et qui dirigent la plupart des villes, sont issus des familles dirigeantes. Ce sont les familles les plus riches. Ce sont les créanciers. En tant que créanciers, ils vont agir dans leur propre intérêt et vont promouvoir une loi axée sur les créanciers, et cela va détruire la société. N’est-ce pas la vérité ?
Puis il passe à ce qui semble une impossibilité. Il dit : « Eh bien, je devine que ce dont nous avons besoin, ce sont des gardiens ! », de nobles despotes. Les gardiens de l’État seraient des gens n’ayant ni fortune personnelle ni vastes domaines. N’ayant ni argent ni biens, ils n’ont pas de dépendance envers la richesse. En n’étant pas « accros » à la richesse, ils souhaiteront développer la société dans son ensemble et non à leur seul profit.
C’est donc bien de cela qu’il s’agit dans La République. Socrate l’a rendu aussi clair que possible, tout comme Aristophane dans les pièces qu’il écrivait à cette époque. D’une manière ou d’une autre, rien de tout cela ne transpire dans le programme que j’ai appris en tant qu’étudiant de premier cycle à l’Université de Chicago, ce qui n’est guère surprenant.
C. A. – Eh bien, je dois dire que, malheureusement, la façon dont ce texte m’a été présenté était à peu près celle selon laquelle il vous a été enseigné. J’aurais souhaité que cela ait davantage changé au fil des ans que cela n’a été le cas, mais peut-être que les gens qui regardent cette vidéo changeront cela à l’avenir. Vous avez parlé d’ « assassinats ». Je suppose que c’est un bon endroit pour enchaîner avec Rome. Entrons donc dans la Rome antique et parlons de ce fondement des lois en faveur des créanciers qui l’ont vraiment tourmentée pendant environ un millénaire, jusqu’à ce qu’elle s’effondre finalement sans trop de résistance. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que fut cette fondation en 500 avant l’ère chrétienne ?
M. H. – En 506 av. J.-C., l’oligarchie se réunit et renversa la royauté. Il n’y a pas vraiment de bonne documentation sur cette période, mais il semble que la plupart des historiens romains ont dit que, pendant que Rome laissait les gens venir d’autres cités pour rejoindre la Ville, non seulement des cultivateurs et des ruraux sont venus à Rome, mais aussi certains aristocrates. Surtout certains aristocrates qui ne pouvaient prendre le contrôle de leurs propres villes et vinrent alors à Rome. Ils essayèrent de se rassembler et ils dirent : « Les rois ne nous permettent pas de gagner de l’argent avec le reste de l’économie ». Alors ils renversèrent les rois en disant : « Nous rétablissons la royauté ». Ce fut tout le mythe du suicide de Lucrèce. Le fils du dernier roi de Rome fut accusé d’avoir outragé la dignefemme d’un de ses proches.
En fait, ce qu’ils ont restauré, c’est la capacité des aristocrates à réduire les clients en esclavage et à user de leurs femmes et de leurs filles. Tout le contraire du mythe historique ! En fait, ils prirent le pouvoir, et immédiatement l’aristocratie renversa tout ce que les rois avaient essayé de faire et régna d’une main de fer. Les Romains avaient suffisamment de conscience de classe pour se retirer de la ville. Ils dirent : « Alors, ce ne sont pas les règles de la Rome à laquelle nous avons adhéré ! » Il y eut sécession de la plèbe vers 490 av J.-C. Ils sont simplement partis jusqu’à ce que, finalement, il y eut une négociation sur le type de structure politique que Rome aurait. Ils ont créé des fonctionnaires censés au moins protéger les plébéiens : les tribuns de la plèbe.
Mais ce n’était pas vraiment une bonne affaire parce que 50 ans plus tard, il y avait encore tellement d’abus de la part de l’oligarchie, d’une oligarchie n’étant pas encore tout à fait une aristocratie, que les juges étaient tous essentiellement des gens riches. C’est pourquoi les Romains ont insisté pour que les lois soient écrites, et non confiées aux juges. Ce devait être la primauté du droit, pas seulement le règne autocratique des gens riches qui contrôlaient la magistrature. Ce fut donc la Loi des Douze Tables [écrite entre 451 et 449 av. J.-C.] qui fixa un taux d’intérêt maximum et diverses règles. Presque immédiatement, l’oligarchie a refusé tout net de lui obéir et a dit : « D’accord, ce sont les règles. Qu’allez-vous faire à ce sujet ? » C’est un peu comme si les États-Unis disaient : « Nous voulons un ordre fondé sur des règles, pas sur la primauté du droit. » Cela aurait pu servir de mot d’ordre à l’oligarchie, mais ils n’avaient pas le président Biden, pour le dire ainsi.
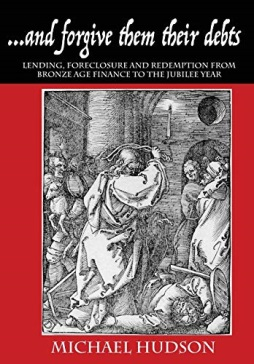
Fig. 2. Couverture du livre …Et Remets-leur leurs dettes. On y voit Jésus s’étant fait un fouet pour chasser les marchands du Temple.
Le résultat fut que, pendant les cinq siècles suivants, encore et encore, vous auriez des patriciens de premier plan, des gens riches, puis des plébéiens de premier plan. De nombreuses familles plébéiennes officielles sont également devenues très riches. Vous aurez des dirigeants politiques qui essaieront de protéger le rôle économique des débiteurs, d’empêcher les gens de tomber dans la servitude et, en fait, d’interdire l’esclavage pour dettes, alors qu’il y avait des exemples particuliers d’abus qui énervaient la population. Donc, fondamentalement, vous veniez d’avoir ce qui semblait être une belle Constitution en papier et des lois sur le papier administrées de manière autocratique, un peu comme si vous essayiez d’appliquer la loi dans les tribunaux de New York. Bonne chance ! Mais cela ne peut aller très loin.
Tout a commencé à se polariser après environ 200 avant J.-C., lorsque Rome conquit le monde grec, absorba la Grèce et poursuivit vers 150 avant J.-C. pour détruire Carthage et conquérir à nouveau la Grèce. Et à ce moment-là, déjà au IIe siècle avant J.-C., Rome se développait en un Empire. Cela a vraiment commencé au IIe siècle. Et parce que Rome appauvrissait sa propre population, l’armée a changé de caractère, devenant plus ou moins une armée de mercenaires fidèles à leurs généraux. Vous avez eu le genre habituel de luttes intestines entre les oligarques de droite et les oligarques plus populistes, et chacun d’eux est devenu un général commandant des armées adverses. Vous avez eu une guerre civile, de 133 av. J.-C. jusqu’à la conjuration de Catilina qui organisa une armée de débiteurs pour essayer d’annuler les dettes. Il perdit. Il avait été quelque peu parrainé par Jules César. Enfin, César exila Cicéron. Son premier acte fut d’annuler les dettes des riches, mais pas celles de sa classe, ni du peuple dans son ensemble. L’oligarchie craignait que César n’annulât en fait les dettes des pauvres, pas seulement celles d’autres riches, et ils l’ont tué. Il y eut une longue lutte pour la succession, et l’Empire a vraiment pris le relais sous Octave, le neveu adoptif de César, qui est devenu Auguste.
C. A. – Exact. Comme vous l’écrivez dans ce livre, Rome avait plusieurs caractéristiques. L’une était d’opérer selon une sorte d’économie de guerre et sur l’appropriation continue des terres des autres, parce qu’elle n’était pas fondée sur le support d’une forte économie domestique.
M. H. – Oui, Rome gagnait surtout son argent en conquérant d’autres régions et en les pillant. Elle imposait un tribut. La partie la plus riche de l’Empire romain pendant de nombreuses années était l’Asie Mineure, ce qui est aujourd’hui la Turquie. Vous avez eu, des décennies durant, une guerre menée par le chef du Pont sur la mer Noire : Mithridate a mené cette guerre contre les Romains détestés à cause de leurs collecteurs d’impôts (qui étaient appelés publicani, « publicains ») ou de leurs agents. Les choses ont tellement mal tourné que vers 88 av. J.-C., il y eut les Vêpres d’Éphèse, partout dans les villes d’Éphèse et du Proche-Orient. Les Proche-Orientaux se sont soulevés et ont tué presque tous les Romains qu’ils pouvaient trouver et tous les Italiens qui les accompagnaient, à l’exception des quelques Romains qui avaient soutenu les droits locaux et étaient devenus indigènes, pour ainsi dire, comme Lucellas, qui était un type bien. Rome revint et a pillé les temples. Il n’y avait pas du tout d’État de droit. L’adage disait : « Là où vont les publicains, l’État de droit s’arrête. » Tout comme les États-Unis, lorsqu’ils prirent le contrôle de la Russie dans les années 1990. Elle fut pillée.
Au Ier siècle de notre ère, un tiers de tous les revenus de l’Empire romain provenait des taxes imposées sur le commerce avec l’Égypte. Ainsi, l’Égypte, avec l’Asie Mineure, est restée une partie essentielle d’un Empire romain qui utilisait ses revenus surtout pour recruter des mercenaires. De plus en plus, Rome s’installe en Europe, au nord des Alpes, et commence à embaucher des tribus germaniques pour combattre pour elle. Habituellement, les généraux commençaient à se battre les uns contre les autres, chacun d’eux voulant être empereur, et ils recrutaient les tribus. Finalement, vers le Ve siècle, l’Empire s’est simplement dissous.
Déjà, au IIIe siècle, censé être l’âge d’or des empereurs, la taxation des zones contrôlées par Rome était devenue si élevée que les empereurs finirent par faire ce que faisaient les dirigeants du Proche-Orient. Ils annulèrent les dettes. Mais attention ! Les dettes qu’ils ont annulées étaient principalement des dettes fiscales, parce que l’économie était si lourdement endettée que les gens ne pouvaient plus se permettre d’emprunter. Les seules personnes alors capables d’emprunter étaient des gens riches, entre eux. La principale cause d’emprunt était le paiement des impôts sur lesquels Rome insistait. Ainsi, lorsque les empereurs ont annulé les dettes, il s’agissait en grande partie d’annuler les dettes des riches, un peu comme les récents renflouements bancaires de la Silicon Valley Bank et d’autres banques aux États-Unis. Les riches n’ont pas à payer les dettes, mais si vous n’êtes pas riche, vous devez les payer. C’est le principe fondamental, et c’est ce que l’Amérique appelle la démocratie.
C. A. – Oui ! tout ça fait beaucoup penser, aujourd’hui, sur une bien plus grande échelle évidemment, à la questio que posait Socrate : faut-il rendre son arme à quelqu’un devenu fou ?
M. H. – En effet.
(Republié de The Analysis avec la permission de l’auteur ou de son représentant)
1 Entretien repris (et adapté) sur le site UNZ du 21 avril 2013 :
https://unz.com/mhudson/debt-and-the-collapse-of-antiquity/
Nous avons conservé le style oral de cet entretien avec Colin Bruce Anthes, analyste en économie et politique, ayant reçu une formation philosophique.
2 Michael Hudson a enseigné aux États-Unis et en Chine. Il a conseillé des gouvernements, y compris au Canada. Il a, à la fois, travaillé à Wall Street et exposé en détail les pratiques de Wall Street. On se reportera utilement à l’art. d’Ellen BROWN, « La clé d’une économie durable a 5 000 ans », Le Cep n°90, mars 2020, p. 43.
3 M. HUDSON, The Collapse of Antiquity. Greece and Rome as Civilization’s Oligarchic Turning Point, Dresde, Islet-Verlag, 2023.
4 Ndlr. La courbe en S monte rapidement à ses débuts, puis passe par un point d’inflexion et la pente diminue, signalant que de nouveaux facteurs limitent la croissance : les arbres ne montent pas jusqu’au ciel ; le pâturage n’est pas indéfiniment extensible ! Tandis qu’avec les intérêts composés s’ajoutant à la somme prêtée, une créance croît de plus en plus vite, et indéfiniment : la somme due devient gigantesque avec le temps. L’image est bien connue qu’un euro prêté à 2 % sous Jules César représenterait aujourd’hui une créance que le patrimoine immobilier mondial ne pourrait couvrir.
