Partager la publication "Le linceul de Turin est-il la nappe de la Cène"
Par Clercq Jean-Maurice
BIBLE
« Le ciel et la terre passeront ; mes paroles ne passeront pas »
(Mt24, 35).
Résumé : Le tissu conservé dans le trésor de la cathédrale Santa-Maria à Coria, en Espagne, serait-il bien la nappe qui a servi pour l’institution de l’Eucharistie lors de la Cène ? Les dernières connaissances réunies sur ce linge, ainsi que toutes les règles d’usage rituel juif au moment de la Pâque, toujours pratiquées aujourd’hui, semblent confirmer la tradition entourant cette relique et pourraient donner des indications précieuses quant à l’origine de la toile du Linceul de Turin.
Du Sabbah
Le shabbat, jour de repos imposé par la loi mosaïque afin de respecter le jour du Seigneur est devenu au fil des siècles d’une application de plus en plus contraignante. YHWH, le Seigneur Dieu tout-puissant voulait éduquer son peuple après la sortie d’Égypte et réveiller en lui un véritable sens religieux qui avait été perverti au contact des religions païennes durant plusieurs siècles de servitude. Il lui donna une suite de prescriptions, tant d’ordre matériel que moral, qu’Israël devait respecter à la lettre. Si toutes ces prescriptions ne lui avaient pas été imposées, ce peuple « à la tête dure », toujours prêt à contester et à se rebeller contre YHWH, ne les aurait certainement pas suivies. Il lui était en particulier demandé une journée de repos hebdomadaire avec l’obligation formelle de n’effectuer aucune sorte de travail. Au fil des siècles, les chefs religieux en sont venus à préciser un certain nombre de points, rajoutant ainsi de plus en plus d’extensions restrictives et s’éloignant de l’esprit du shabbat pour en faire un ensemble de prescriptions de plus en plus contraignantes. Le travail – essentiellement manuel dans l’antiquité – était symbolisé, dans les interdictions de la Torah, par le geste de lever quelque chose avec le bras suivi par celui de l’abaisser.
Dans cet esprit, puiser l’eau du puits était ainsi spécifié : si on la puisait avec un seau sans surcharge ni lest pour qu’il se remplisse tout seul une fois au fond du puits, on n’enfreignait pas le shabbat. Mais si le récipient à remplir était léger comme une calebasse évidée et lestée d’une pierre ou d’une brique par exemple, celle-ci allait descendre puis remonter, alors son trajet était assimilable à un geste de maçonnerie, donc de travail. De même si l’on donnait une pièce à un mendiant, le fait de prendre une pièce et de la donner était interdit pour la même raison (semblable à un acte de commerce). Pour respecter le repos sabbatique, la pièce était donc posée sur le rebord de la fenêtre et le mendiant la prenait. Il en était de même pour servir l’eau le jour du sabbat : il est interdit de soulever la cruche et de la reposer. L’interdiction était contournée en faisant servir l’eau par un enfant (non encore astreint au sabbat) ou en se servant d’une fontaine à eau. Une exception, tout de même, en cas d’incendie de sa maison : il était permis de lutter contre le feu en puisant de l’eau et en la jetant sur les flammes, mais dans la stricte nécessité de pouvoir sauver les livres religieux s’il y en avait, avec une tolérance supplémentaire pour sauver les vêtements si l’incendie se passait de nuit et que l’on n’était pas habillé convenablement ; de même pour la nourriture dont la quantité devait être strictement celle qui était nécessaire pour une journée… On comprend que Jésus ait déclaré aux pharisiens : « le shabbat a été fait pour l’homme et non l’homme pour le shabbat » (Mc 2, 24). On comprend aussi pourquoi ces mêmes pharisiens reprochèrent aux apôtres de ne pas respecter le shabbat en arrachant et en froissant quelques épis de blé, ce qui était considéré comme un geste de moissonnage et de vannage. La vie moderne a considérablement compliqué les obligations sabbatiques, comme on va le voir. De nos jours certains rabbins orthodoxes posent la question de l’opportunité de remplacer la classique serrure à clé par un digicode ou bien une carte magnétique pour éviter le geste de prendre la clé. D’autres en sont venus à se demander si on peut faire l’usage de l’électricité du fait que cela engendre une étincelle, tout comme de mettre sa voiture en marche, car il est strictement interdit d’allumer ou entretenir du feu pendant le repos sabbatique… [une étincelle est assimilable à du feu ou à faire du feu].
La logique est poussée plus loin encore quant au papier toilette en rouleau : on interdit le prélèvement des feuilles, car il y a transformation de la matière qui, d’une bande continue, passe, à plusieurs morceaux séparés identiques. Cette transformation du papier est assimilable à un travail. Pour régler ce problème particulier concernant l’hygiène intime, plusieurs solutions sont proposées : préparer à l’avance la quantité de feuillets nécessaire, utiliser un bloc de papier à feuillets unitaires séparés ou encore des mouchoirs jetables.
Il est établi aussi, pour la fête de la Pâques (Pessah), une liste annuelle de produits alimentaires de la grande distribution, autorisés ou à rejeter selon qu’ils contiennent ou sont susceptibles de contenir des traces de farines de céréales fermentées (hamets)1. Sont ajoutés à la liste, dans le même esprit, des médicaments contenant des remèdes allopathiques, phytothérapeutiques ou homéopathiques. Certains rabbins, encore plus pointilleux, estiment que lors de la fabrication du pain azyme, si l’eau reste en contact plus de 17 secondes avec la farine sans que la pâte soit travaillée, elle doit être considérée comme pâte levée, donc impropre pour fêter Pessah… La remarque de Jésus sur les observations sabbatiques reste donc toujours d’actualité.
Comme il était interdit d’allumer le feu et de préparer le repas le jour du sabbat, on mangeait froid un repas qui avait été préparé la veille et posé sur une table en attendant. Il fallait protéger la nourriture des poussières et des insectes qu’elle aurait immanquablement attirés. À cet effet, on utilisait une nappe rituelle décorée, ou nappe de shabbat, étroite et longue (traditionnellement quatre fois plus longue que large2) pour recouvrir les plats. Pour la grande fête religieuse de Pâque (Pessah), on utilisait une deuxième nappe sans ornements sur laquelle on posait les plats pour les isoler de la table. Il y avait donc deux nappes : une nappe sous les plats préparés et une au-dessus.
Du repas de la Pâque ou Pessah
Le repas de Pessah, ou seder, procédait de tout un rituel spécifique très codifié. La moindre parcelle de pain fermenté (appelé « hamets ») devait être soigneusement éliminée et détruite par un nettoyage minutieux de tout ce qui avait pu être au contact du pain, jusque dans les plus petits recoins, allant jusqu’à l’inspection des coutures des nappes où pourraient se cacher quelques minuscules miettes. La préparation de la Pâque juive était donc précédée d’un ménage complet des pièces de vie avec leur mobilier, la vaisselle et les ustensiles de cuisine, bref de tout ce qui aurait pu être au contact du pain fermenté et en conserver des traces. Était conseillée une procédure, précisée avec le temps, car toute trace de hamets pouvait rendre impropre le lieu et les objets « contaminés » destinés à célébrer Pessah3.
Cette suppression du hamets est une affaire prise très au sérieux depuis toujours. Cela prend toute une journée (ou plus selon la grandeur de l’habitation) et se réalise le jour précédant celui de l’entrée en sabbat, nommé «jour de la Préparation ». Comme on ne pouvait être totalement sûr de la « kachérité » de la table sur laquelle le repas pascal allait être servi (c’est-à-dire qu’elle fût rituellement propre à la célébration, totalement exempte de hamets : on ne sait jamais, au fond d’une fissure…), on avait pris l’habitude, à l’époque de Jésus, lorsque cela était possible, d’utiliser des pièces ne servant pas habituellement aux repas et d’étendre sur le bois de la table une nappe rituelle supplémentaire sans ornements sur laquelle on pouvait alors poser la nourriture sans crainte d’impureté.
Les Hébreux en étaient arrivés à utiliser des nappes rituelles ne servant que pour Pessah. Le repas pascal suivait une liturgie précise et comprenait, entre autres, six plats dont le symbolisme correspondait avec le récit de l’Exode, des piles de trois pains sans levain en rappel de la triple sainteté de Dieu, quatre coupes de vin pur ou coupé d’eau (ou de jus de raisins pour les plus jeunes), bues accoudé sur le bras gauche, et qui, selon l’exégèse rabbinique, relatent les différentes étapes de l’intervention divine dans la délivrance des Hébreux, et une cinquième coupe, la coupe d’Élie (devant revenir sur terre pour annoncer le temps messianique4). Il y avait bien sûr l’agneau rôti, à consommer intégralement. On comprend donc que, lorsque Pessah réunissait beaucoup de monde, il devint nécessaire d’utiliser des nappes deux fois plus grandes (2 coudées de larges sur 8 de long), ce qui était le cas pour la Cène.
Le rite du pain sans levain (matzot) fait l’objet de toute notre attention par son rituel : au milieu du repas, le pain sans levain est brisé en deux par le célébrant et une des moitiés est enveloppée dans un linge blanc, puis placé sous la nappe du dessous, à l’une des extrémités de la table. À la fin du repas, l’officiant ressort, rompt le pain et en distribue les morceaux aux convives. Ce dernier cérémonial (appelé aphicoman), qui marque la fin du repas, n’est pas sans rappeler d’une manière symbolique l’ensevelissement et la mise au tombeau de Jésus ; la fraction du pain nous ramène à l’instauration de l’Eucharistie, au moment où Jésus rompit le pain après l’avoir béni et dit « Ceci est mon corps livré pour vous » avant de le partager à ses apôtres.
Quel rapport, maintenant, entre la nappe rituelle de Pessah et la relique conservée en la cathédrale Santa-Maria à Coria (Espagne) ?
La cathédrale espagnole Santa-Maria de la Asunción de Coria, petite ville située près du Portugal, à l’ouest de Madrid, possède certainement une origine des plus anciennes de la péninsule ibérique. Le bâtiment actuel, considéré comme un chef-d’œuvre exceptionnel du baroque espagnol, a été édifié de 1498 à 1748, puis restauré car gravement endommagé à la suite du séisme violent du 1er novembre 1755 qui détruisit Lisbonne. Il succédait à une mosquée construite lors de l’occupation sarrasine, qui avait été bâtie sur l’ancienne cathédrale wisigothe.
Cette dernière avait elle-même été édifiée sur une construction romaine, probablement une basilique, dont on a retrouvé des mosaïques qui dateraient du premier siècle, ce qui laisse à penser que cette première construction pourrait être le premier édifice chrétien de la péninsule.

Fig. 1. La cathédrale Santa-Maria de la Asunción, à Coria.
L’intérêt de cette cathédrale réside dans son trésor qui est la cause de l’origine des constructions successives destinées à servir d’écrins pour une relique très précieuse: la nappe rituelle ayant servi lors du dernier repas de Jésus avec ses douze apôtres. Comme il en va maintenant à l’égard des reliques, les historiens considèrent que la tradition n’est pas une preuve d’authenticité complète et que celle-ci demande à être confirmée.
On a donc commencé à s’intéresser de près à cette relique, en particulier le physicien John Jackson bien connu des sindonologistes pour la qualité de ses recherches sur le Linceul de Turin. Des études récentes apportent de premières confirmations sur l’origine palestinienne antique affirmée par la tradition.
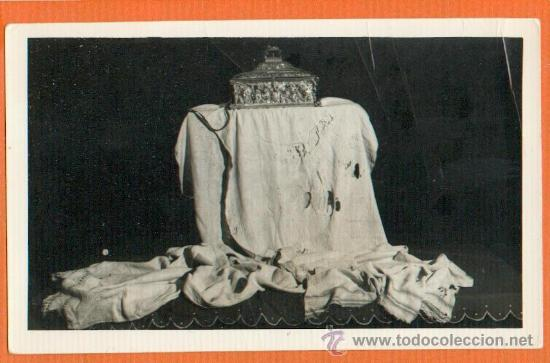
Fig. 2. La nappe de Coria sortie de son reliquaire.

Fig. 2. La nappe de Coria remise dans son reliquaire.
Ces études établissent aussi un lien entre la nappe rituelle et le Linceul de Turin :
- Les deux toiles sont en lin ;
- elles pourraient avoir été tissées en même temps ;
- leurs dimensions spécifiques, que l’on pensait être réservées au tissage de la soie, semblent montrer qu’elles répondent à un même usage bien précis : celui de nappe rituelle ;
- la similitude de leur très grande et peu courante dimension, incite à penser que le Linceul de Turin et la nappe de Coria avaient pu être utilisés pour la même table préparée pour Pessah.
Dans ce cas, le Linceul de Turin serait la nappe rituelle du dessous et celle de Coria, celle du dessus. En tous cas, rien ne s’oppose à ces conclusions en l’état des connaissances. Rebecca Jackson5, née dans une famille juive traditionnelle, fut la première à attirer l’attention sur cette donnée. En la commentant, Ignacio Dols, un délégué de la Société espagnole de sindonologie, déclara dans le journal El Mundo, que tout ceci était vraisemblable car Jésus fut enseveli dans la précipitation.
En effet, pour quelle autre raison aurait-on utilisé une nappe comme Linceul ?

Fig. 4. La nappe étalée pour un examen scientifique.
Dès lors, la nappe rituelle décorée conservée dans la basilique Santa Maria de Coria serait la nappe du dessus qui aurait été pliée et rangée pour le repas du sabbat; la seconde nappe, celle du dessous, sans ornement, celle sous laquelle aurait été glissé la moitié du pain azyme avant qu’il ne fût distribué aux apôtres, serait donc le Linceul de Turin.
Examinons de plus près si l’affirmation d’Ignatio Dols est bien fondée.
Les Évangiles précisent :
- « déjà le soir était venu et comme c’était le jour de Préparation, c’est-à-dire une veille de sabbat, un membre éminent du conseil, Joseph d’Arimathie, arriva … Il eut le courage d’entrer chez Pilate pour demander le corps de Jésus…après avoir acheté un linceul (texte de la TOB, ou « une toile de lin pure » selon la traduction de Claude Tresmontant), Joseph descendit Jésus de la croix…»).
(Mc 15, 43-47)
- « le soir venu, arriva un homme riche d’Arimathie. Cet homme alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus …Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul propre » (texte de la TOB, ou “une toile de lin pure” selon la traduction de Claude Tresmontant).
(Mt 27, 57-60)
Ces passages d’Évangiles sont complémentaires et méritent d’être bien compris.
Pourquoi cette volonté de descendre rapidement le corps de Jésus ? L’exécution terminée, les Romains abandonnaient les corps aux juifs. En cette veille du sabbat, les corps devaient être retirés avant le coucher du soleil (Dt 21, 22-23) et déposés dans un cimetière prévu par la justice. Les disciples présents au pied de la croix avaient le désir d’une sépulture décente pour Jésus et préféraient donc s’en occuper eux-mêmes. D’où la démarche de Joseph d’Arimathie.
Mais que veut dire « soir » pour le judaïsme de l’époque du Christ ?
Le soir est la période comprise entre le coucher de soleil sur l’horizon et l’apparition des trois étoiles de première grandeur qui marquent l’entrée en sabbat une petite heure plus tard, ce que le Temple signale par des sonneries de trompettes6.Les textes évangéliques précisent bien que c’était alors la fin de la journée.
Pourquoi cette précision d’un linceul propre, ou plus exactement « une toile de lin pure » ? C’est un fait que l’évangéliste a tenu à donner cette précision. Il aurait pu dire tout aussi bien : un linceul neuf. Cette distinction possède donc son importance et ne signifie pas un simple état de propreté mais une pureté rituelle, une pureté lévitique7, comme c’était le cas pour la nappe rituelle de Pessah et comme ce ne pouvait pas l’être pour un linge venant d’être acheté chez le commerçant.
Peut-on trouver d’autres précisions ?
Il est conservé dans la cathédrale d’Oviedo dans les Asturies, toujours en Espagne, un linge en toile de lin de 83 x 63 cm. Les recherches très approfondies qui ont été effectuées montrent que ce linge avait été posé sur la tête de Jésus en croix après le coup de lance8 .
Les expérimentations des légistes ont pu déterminer les conditions de formations de ses taches biologiques, qui ont maculé le tissu (sang et liquide d’œdème pulmonaire dans une proportion de 1 à 6), quant au temps de séchage et à la position du corps, d’une manière extrêmement précise permettant de reconstituer la fin de la Passion en temps et en mouvements du corps depuis la mort de Jésus jusqu’à sa mise en tombeau9 :
15h (ou neuvième heure du jour) : Jésus meurt sur la croix ;
15h-16h : les prêtres demandent à Pilate d’achever les crucifiés avant l’arrivée du sabbat, afin de ne pas souiller la ville d’une impureté légale ;
16h-16h15 : les soldats vont achever les crucifiés, et le corps inanimé de Jésus reçoit le coup de lance. Un suaire va être mis sur la tête de Jésus toujours en croix, conformément à l’usage qui exigeait la pose d’un suaire sur la tête d’un mort victime de violence. Le corps de Jésus restera ainsi sur la croix pendant une heure environ sans être déplacé ;
17h30 : le corps de Jésus est descendue de la croix pour être remise à Marie : il est déposé sur le sol en décubitus latéral droit, le bras droit étiré. Il restera ainsi pendant 1 heure à 1 heure quinze, temps que Joseph d’Arimathie mettra à profit pour se mettre en recherche d’un linceul. L’heure tardive et les cérémonies du Temple proches de s’achever, toutes les échoppes des commerçants susceptibles de vendre un linceul étaient certainement fermées comme les autres. Il ne restait alors à Joseph que la solution de la nappe rituelle de Pessah qui était blanche et rituellement pure. Il n’allait pas prendre la nappe du dessus qui était décorée, car le linceul devait être blanc. C’est ce qui lui a permis de ne pas trop traîner et d’être de retour pour le soir vers 18 h 30, puis d’emmener avec Nicodème le corps de Jésus vers le tombeau situé non loin…
Le sabbat commence aux alentours de 19 h 03 selon notre calcul horaire. Joseph d’Arimathie et Nicodème n’ont que le temps de placer le Seigneur dans le tombeau, de recouvrir son corps sommairement du linceul et de refermer le tombeau en roulant la pierre. Le sabbat terminé, on reviendra faire la toilette funéraire qui comprend le nettoyage du corps, la coupe des cheveux et de la barbe et différents rites funéraires.
Ces horaires ont été déterminés suite à de longues recherches et expérimentations effectuées par des médecins légistes espagnols à partir des reconstitutions des taches du Suaire et de leur temps de séchage pour obtenir des images identiques. Leurs formes ont permis de déterminer les mouvements nécessaires à leur formation. Le décompte des temps de séchages et d’écoulements commencent à 15h, heure de la mort de Jésus sur la croix.
Selon ce scénario, l’utilisation de la nappe rituelle semble une solution parfaitement crédible et acceptable.
Nous ne sommes que dans le premier temps des études sur la nappe de Coria, et les informations qu’elles pourraient révéler dans les années à venir seront certainement à suivre de près.
1 Les céréales interdites sont : le blé, l’épeautre, l’orge, l’avoine et le seigle.
2 La nappe rituelle, toujours en usage de nos jours pour le shabbat, est vendue aux dimensions suivantes 0,50 m x 2 m, soit environ 1 x 4 coudées gréco-romaines.
3 Au sujet du pain azyme, sans levain donc non fermenté, certaines interprétations actuelles édictent que si la farine a été en contact plus de 17 secondes avec de l’eau, ou quelque liquide ou substance humide, elle devra être considérée comme « levée ».
4 Lorsque Jean-le-Baptiste baptisait dans le Jourdain, des prêtres et des lévites avaient été envoyés de Jérusalem pour savoir qui était Jean : « et ils lui demandèrent : “ Qui es-tu ? Es-tu Élie ?” » (Jn 1, 21).
5 Rebecca Jackson est la femme de John Jackson.
6 Le soir correspond plus précisément au crépuscule et se définit par rapport à la position du soleil sur l’horizon. Dans le cas présent, le crépuscule à retenir n’est pas le crépuscule civil (entre 0° et 6° sous l’horizon), mais le crépuscule nautique qui retient une position du soleil entre 6° et 12° en dessous de la ligne d’horizon, de sorte que l’on puisse voir à la fois les étoiles de première grandeur et la ligne d’horizon, afin de pouvoir calculer sa position.
À Jérusalem, au moment de la Passion, le crépuscule nautique était exactement de 55 minutes d’arc (pisitowwwdateandtime.info). Le soleil se coucha ce jour-là à 18h 08.
7 Claude TRESMONTANT, Évangile de Matthieu, traduction et notes, Paris, Éd. de l’ŒIL, 1986, p. 504.
8 Dr Jean-Maurice CLERCQ, La Passion de Jésus, Paris, F-X de Guibert, 2011, page156-158.
9 Idem.
