Partager la publication "Les EMI (partie II) [expériences de mort imminente]"
Par Saint-Remy De Régis
Résumé : Après avoir décrit le phénomène des « expériences de mort imminentes » (EMI), désormais pris au sérieux et bien étudié par plusieurs auteurs, souvent des médecins (cf. Le Cep n° 83), il convient d’en venir à son explication : elle peut être scientifique (§ 2) ou religieuse (§ 3).
Les interprétations scientifiques matérialistes classiques n’étant guère convaincantes, certains font appel à la physique quantique pour élargir le cadre et y inclure les faits de télépathie, de médiumnité ou de télékinésie. Mais ces études, assez théoriques, ne font pas droit à la dimension proprement spirituelle dont bien des « expérienceurs » font état. Ici vient se placer la frontière entre le paranormal et le surnaturel véritable. Ici les règles magistèrielles transmises par l’Église deviennent d’un apport irremplaçable.
II. LES ANALYSES SCIENTIFIQUES DES EMI.
Insuffisance de la médecine dite classique1
La médecine dite classique (c’est-à-dire mécaniste et scientiste) cherche à expliquer les EMI par trois théories qui ont été résumées par le Dr Van Lommel2 :
La première résulte d’un matérialisme moniste où tout ne doit être que matière : « Puisque le cerveau est formé de neurones soumis à des processus physiques et chimiques, il suffit d’expliquer ces processus pour expliquer la conscience. » Si cela était vrai, les EMI ne seraient que de simples illusions comme nous l’avons déjà vu3. La deuxième, quant à elle, part de la conscience, laquelle devrait s’identifier à des processus cérébraux comme ce fut remarqué lors de plusieurs expériences. Enfin, si la troisième théorie accepte de ne pas réduire la conscience aux processus cérébraux, elle considère, comme la précédente, que le progrès scientifique matérialiste expliquera tôt ou tard les EMI. C’est ce que l’on appelle le « matérialisme de promesse ».
Toutefois, ces arguments ne sont guère convaincants, surtout depuis l’intervention chirurgicale très risquée (ablation d’un volumineux anévrisme près du tronc cérébral) et sous monitorage (surveillance du patient par appareils automatiques) de Pamela Reynold, en 1991, à l’occasion de laquelle cette jeune femme fit une EMI. Avant l’opération, qui dura de longues heures, son corps fut incliné afin que le cerveau se vidât entièrement de son sang. Ce qui ne l’empêcha pas de révéler ensuite, en plus de son EMI particulièrement complète, des détails époustouflants (dialogues du personnel médical reconstitués au mot près, appareils chirurgicaux cachés à la patiente et manière précise d’opérer) sur ce qu’elle ne pouvait ni voir, ni entendre pendant l’intervention. Surtout que la température de son corps était signalée à 15,5 degrés, ce qui, en plus de l’anesthésie générale et de l’arrêt provoqué du cœur entraînant un EEG plat, empêchait tout échange biochimique entre deux neurones.
Le monitorage aidant, cette expérience aura démontré, une fois de plus, qu’une EMI peut s’effectuer en l’absence de toute activité cérébrale, y compris du lobe temporal droit qui fonctionne spécialement lors des manifestations mystiques.
Mais loin de s’avérer battue, la médecine classique, pour expliquer une EMI, invoque soit une hypoxie (manque d’oxygène), soit une hypercapnie (excès de gaz carbonique), les conclusions restant les mêmes : la mort cérébrale interdit tout mécanisme du cerveau. En ce qui concerne les réactions chimiques de ce dernier, que ce soit avec la kétamine ou les drogues psychédéliques (DMT, LSD, psilocythine et mescaline), certaines pourraient provoquer (surtout le DMT naturellement produit par l’organisme) un rapprochement avec le début de certaines EMI, mais sans précisions aussi nettes, ni de sensation de « décorporation » avec perceptions vérifiables, ni de film de vie, ni de rencontre de personnes décédées, tout ce qui caractérise justement une EMI.
Enfin, une quelconque activité électrique du cerveau (épilepsie, stimulation) durant une mort cérébrale est à rejeter, de même que toute théorie psychologique (peur de la mort, fantasmes, mystification, hallucination, rêves ou illusions provoquées par médicaments), toujours pour la même raison.
Certes, la médecine classique s’aperçoit parfois que l’esprit occupe une première place dans les neurosciences. La neuroplasticité, par exemple, qui est cette adaptation permanente du cerveau à ce qui l’entoure, ainsi que toutes ses conséquences comme l’effet placebo, la psychothérapie ou la thérapie comportementale cognitive concluent au fait que c’est l’esprit qui influence le cerveau et non l’inverse.
En fait, cette médecine matérialiste est désarmée pour expliquer n’importe quel processus qui obéit à d’autres lois que mécaniques, telles que les liaisons des neurones entre eux (synapses), toutes subjectives et quasi-illimitées ou, mieux encore, le processus d’auto-organisation, d’autorégulation et d’auto-régénération du cerveau. Si tant est que certains d’entre eux soient visibles et mesurables, ils ne sont que le fruit d’une volition qui, elle, est invisible et non mesurable.
EMI et physique quantique4
La médecine classique utilise déjà la physique quantique, notamment avec l’IRM (imagerie à résonance magnétique) en ce qui concerne la personne humaine. C’est une sorte d’hologramme photographique qui reproduit deux ou trois dimensions, mais qui ne détermine que l’activité sanguine du cerveau. C’est donc insuffisant pour connaître le rayonnement des champs électromagnétiques autour des synapses, témoins de toute activité neuronale, et encore bien plus pour expliquer ce qu’on appelle « la délocalisation de la conscience ».
Le mérite du Dr Van Lommel n’est pas d’avoir trouvé une nouvelle application de la physique quantique dont les différentes facettes restent à explorer5, mais d’avoir trouvé une analogie entre ses principes même et une EMI. Essayons de les résumer : si, en physique classique, tout objet possède un corps aux dimensions mesurables de façon continue, la physique quantique, elle, ne s’intéresse qu’au« saut quantique » dont l’image traditionnelle est celle d’une balle qui rebondit dans l’escalier. Ce n’est donc pas la matière qui l’intéresse, mais les ondes discontinues qu’elle propage. Elle n’attribue pas de valeur à un corps composé de particules, mais uniquement aux champs où se manifestent ces ondes. Dans la physique quantique, l’espace remplace l’objet. Ce qui est difficile à comprendre, c’est que cette physique est subjective, puisque chaque corps, selon son état, a une signature qui lui est propre.
Cela comporte plusieurs conséquences : d’abord la physique quantique est animée par le principe de « non-localisation » du fait que les ondes, intriquées entre elles dans un espace donné, sont capables d’influencer d’autres champs. Ces ondes ne sont que des « ondes de probabilités », accentuant encore, aux yeux des matérialistes, l’incertitude et le subjectivisme de la physique quantique. D’autant plus qu’il y a un corollaire : le principe de non-localisation implique que les corps n’aient pas de contact local, c’est-à-dire matériel.
Une autre conséquence est que cette intrication des ondes laisse apparaître leur diversité, et une diversité qui s’annonce infinie. En quelque sorte, cet enchevêtrement d’ondes est comparable à une gigantesque toile d’araignée régie par une cohérence invisible sans laquelle l’univers, s’il était désordonné, ne saurait exister. Si bien que, par définition, les fondements physiques de notre univers ne sont mesurables en aucune manière.
Pour qui passe de la physique classique à la physique quantique, à condition qu’il en assume le raisonnement jusqu’au bout, c’est sa vision du monde qui s’en trouve entièrement changée, avec non pas le hasard comme harmonie, mais bel et bien un principe universel invisible.
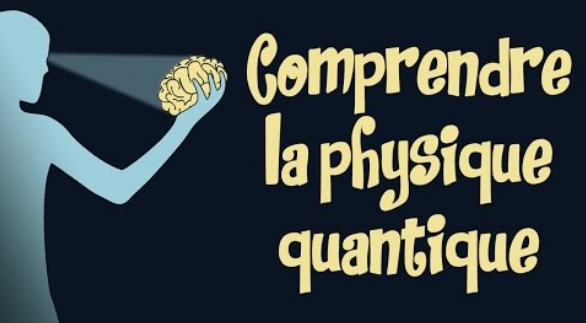
Toutes ces caractéristiques de la physique quantique, expose le Dr Van Lommel, se retrouvent par analogie dans une EMI comme dans toute autre manifestation (bonne ou mauvaise) de la conscience agissant hors du cerveau, que ce soient l’hypnose, la télépathie (transmission de pensée), le magnétisme, la médiumnité (à ne pas confondre avec le charlatanisme ou son utilisation commerciale augmentée de manipulations psychologiques), la télékinésie (pouvoir de bouger les objets sans les toucher), les prémonitions, etc.
Dans une EMI, il y a une manifestation de la conscience infinie dans un espace non-local (et hors du temps) seulement lorsqu’il y a eu cette impression de « décorporation », non seulement par celle-ci, mais aussi par ce que peut percevoir la conscience à cette occasion, telle que l’intervention chirurgicale sur son propre corps ou, mieux encore, le film de sa vie passée et parfois des événements futurs. Le fait que toute communication, lors d’une EMI, ne puisse se faire que par télépathie est aussi une résultante de ce principe de non-localisation. Enfin, une EMI exerce une influence subjective, non mesurable mais bien réelle, sur la volition de la conscience de l’« expérienceur », étant donné que celui-ci change de vie après son EMI.
Pour parfaire l’analogie, le Dr Van Lommel insiste sur la complémentarité onde-particule de la physique quantique que l’on retrouve aussi lors d’une EMI : dans celle-ci, le côté onde est celui de la conscience délocalisée, tandis que le côté particule est celui de la « conscience de veille incarnée », c’est-à-dire la conscience du sujet éveillé, dépendante corporellement du cerveau composé de particules.
Ces deux côtés, qui constituent l’interface d’une seule et même conscience (un peu comme une pièce de monnaie), ne peuvent se manifester ensemble. La « décorporation » est précisément le moment où l’on passe de l’un à l’autre, c’est-à-dire quand le côté-particule se transforme en côté-onde. Alors désincarnée, délocalisée, libérée du cerveau qui l’astreignait aux contingences du temps et de l’espace, la conscience peut s’élancer dans l’univers non-local et infini. À son tour, elle devient infinie et peut, toujours de manière infinie, se contacter à d’autres consciences.
Ainsi, sans définir la conscience elle-même, voici, selon le Dr Van Lommel, l’explication théorique du processus des EMI, mais aussi celui de la télépathie, du magnétisme, de l’hypnose, etc.6 Si bien que le cerveau ne joue qu’un rôle de médiateur ; il n’est pas un « sécréteur de conscience » comme le pensent les matérialistes, mais plutôt l’ « émetteur-récepteur » de la conscience, en sorte qu’on pourrait le comparer à un poste de télévision qui reçoit des informations pour les divulguer à nouveau.
Le concept de conscience intuitive extraneuronale conduit à la preuve scientifique de l’au-delà7
Le concept de « science intuitive extraneuronale », inventé par le Dr Charbonnier, complète le raisonnement du Dr Van Lommel. Il a reçu une consécration officielle, à Reims, en 2014. Sans doute est-il plus facile à comprendre, puisque c’est l’autre nom pour « conscience délocalisée » ou conscience extra-cérébrale. L’interface de ce concept de « conscience intuitiveextraneuronale » (CIE) est celui de « conscience analytiquecérébrale » (CAC) ou conscience intracérébrale – équivalent de « conscience de veille incarnée » chez le Dr Van Lommel –, laquelle est la conscience qui dépend du cerveau.
Étroitement lié à la vie terrestre, le fonctionnement de la CAC résulte d’échanges biochimiques complexes entre les différents neurones organisés en réseaux. En cas de manque d’oxygène qui paralyse un de ces réseaux, par exemple lors d’un accident vasculaire cérébral, cette CAC est capable d’organiser des réseaux de substitution. Cette plasticité neuronale a toutefois ses limites en cas de dégénérescence définitive des cellules, comme dans la maladie d’Alzheimer et dans les cas de maladies mentales où les réseaux sont définitivement endommagés ou se bloquent.
Le rôle de la CAC est d’analyser et de trier les informations données par nos cinq sens en stockant, déployant, préférant, sélectionnant ou même refusant ces informations selon les circonstances dans lesquelles elle se trouve, le tout sans cursus forcément rationnel, pour les restituer ensuite dans l’espace et le lieu de manière opportune. Bien qu’elle reste libre dans ses choix, on se doute bien que son éducation, sa formation et ses orientations durant la petite enfance influent considérablement ses choix de l’avenir qui s’effectuent alors selon ces repères reçus.
On peut mesurer sa puissance : au-dessus de 24 hertz (Hz), son activité est intense ; de 12 à 24 Hz (rythme bêta), c’est celle des actions de la vie quotidienne ; de 8 à 12 Hz (rythme alpha), elle est au repos ; de 4,5 à 8 Hz (rythme thêta), c’est celle de la méditation et du sommeil léger ; en dessous de 4 Hz (rythme delta), elle est éteinte et c’est le cas d’un sommeil très profond ou celui d’une mort clinique, là où on peut connaître une EMI.
En bas âge, la CAC est encore faible puisque la conscience apparaît avec la naissance, mais au fur et à mesure que la vie s’avance, les synapses qui la composent s’accroissent par la somme d’informations qu’elle reçoit, surtout si celles-ci sont intellectuelles comme les études universitaires.
Ce qui explique un nombre moins important d’EMI chez les anciens et chez les intellectuels que chez les jeunes, car, dans le premier cas, la CAC est tellement importante (le Dr Charbonnier dit « assourdissante » ) que la CIE, son interface, a de la peine à se manifester.
Au moment de la mort, la CAC disparaît complètement (puisque le corps ne vit plus) et la CIE, nantie du bagage neuronal obtenu par la CAC au cours de son existence terrestre (vu que la conscience est une), est pleinement et définitivement activée dans ce que le Dr Charbonnier appelle le « champ universel de conscience » qui rassemble le savoir universel contenu dans tout l’univers. Une réinterprétation fondamentale (l’expression est du Dr Charbonnier) des quanta va lui permettre de créer, lui aussi, une analogie entre la complémentarité onde-particule (cf. paragraphe précédent) et la complémentarité CIE-CAC dans laquelle la CIE serait les quanta et la CAC le corps d’où émaneraient ces quanta.
Pour le Dr Charbonnier, sont ainsi scientifiquement exposées l’immortalité de l’âme par sa complémentarité CIE-CAC, la rétribution de celle-ci par l’« inscription » de la CIE sur le « champ universel de conscience », ce qui inclut, en conséquence, l’existence d’un grand Ordonnateur soit Dieu lui-même8.
Ce qui nous intéresse ici, comme dans le cas des EMI, ce sont les moments de l’existence où cette dualité CAC-CIE se concrétise en interaction (ou double permutation).
Il y a d’abord les quatre cas classiques d’apparente inconscience où la CIE inhibe la CAC : le sommeil physiologique, le coma, les anesthésies générales et, bien sûr, la mort cardiaque. Il y en a d’autres que le Dr Charbonnier a relevés et que nous citons pêle-mêle : la méditation, la générosité spontanée ou l’amour inconditionnels (sans réflexion), les découvertes, la création artistique, l’hypnose, la voyance, la médiumnité, la consommation de drogues psychédéliques (LSD), les transes occasionnées par les plantes hallucinogènes d’Afrique (iboga) ou d’Amérique du Sud (ayahuesca), les expériences chamaniques, etc., mais aussi les cas de possessions et de suggestions diaboliques durant lesquelles une CIE négative, explique le Dr Charbonnier, peut influer sur une CAC9.
Lors de la fin (ou au réveil) de ces occasions, lorsque la CAC inhibe à nouveau la CIE, toutes ses informations ne pouvant être acceptées (toujours cette dualité) par la CAC, celle-ci les étouffe la plupart du temps. C’est pourquoi nous ne nous souvenons que rarement de nos rêves ou de ce qui s’est passé durant un état hypnotique. Comme le hasard quantique, les traces de ceux-ci restent aléatoires, irrégulières, incertaines et partielles.
Elles peuvent être rares, comme dans les EMI, quand les souvenirs peuvent être restitués intégralement. D’autres, comme les rêves prémonitoires ou les visions de l’avenir, resteront toujours inexpliquées10.
Terminons en soulignant que l’intérêt du Dr Charbonnier est thérapeutique au sens noble du terme, puisqu’il cherche à guérir corps et âme. À l’exemple du Dr Élisabeth Kübler-Ross qui utilise (elle a créé des équipes à cette intention) le message donné par les EMI pour accompagner les mourants, ses préoccupations sont celles d’un médecin soucieux de soigner les maladies physiques et mentales en influant sur la CAC de ses patients, grâce à différentes méthodes comme l’utilisation de vrais médiums pour discuter avec des patients dans le coma ou par l’entremise de la prière.
III. APPROCHE RELIGIEUSE DES EMI ET LE MESSAGE DE L’ÉGLISE.
Réponses aux incertitudes : les lois universelles
Malgré la brillante cohérence de leur exposé, les théories scientifiques des Drs Van Lommel et Charbonnier sur les EMI laissent transparaître, plus ou moins ouvertement, des insuffisances et inexactitudes métaphysiques difficilement évitables sans l’apport d’une révélation extérieure qui expose les fins dernières, à condition, bien évidemment, d’y croire.
On peut d’abord discuter de termes comme « mort provisoire » ou « décorporation » (cf. paragraphe « Quand sedéroule une EMI » de la 1ère partie) qui demandent, l’un autant que l’autre, de franches explications. Il est ensuite nécessaire de corriger la croyance en la réincarnation (ou transmigration des âmes) adoptée par le Dr Charbonnier, le Dr Kübler-Ross et peut-être le Dr Van Lommel (il reste prudent à ce propos) pour ne parler que d’eux, alors que le processus de la mort la rend peu crédible, voire ubuesque11. Ajoutons enfin que certaines précisions seront les bienvenues à propos des EMI.
Pour commencer, insistons sur le fait que la mort, séparation de l’âme immortelle et du corps corruptible, est une loi commune à tous les hommes seulement depuis le péché originel12 car, énonce saint Paul (Rm 5, 12), « par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a passé dans tous les hommes parce que tous ont péché ». L’Apôtre précise par ailleurs : « Les hommes ne meurent qu’une fois » (He 9, 27). La Tradition catholique affirme de manière catégorique que la mort, en tant que terme d’« état de voie » terrestre, résulte de la volonté souveraine de Dieu, seul maître de la vie et de la mort : « C’est moi qui fais mourir et qui fais vivre » (Dt 32, 39). Comme c’est une conséquence du péché originel, c’est la justification de notre seul passage sur terre. Par conséquent, il ne saurait y avoir de mort temporaire.
Les conséquences de cette unicité de la mort sont autant de nouvelles preuves : à la mort, il existe un jugement définitif de chaque âme par Jésus-Christ, comme nous l’apprennent la parabole des dix vierges, celle des talents (Mt 25), ou encore celle de Lazare et du mauvais riche (Lc 16). Au moment de la mort, bien et mal sont définitivement séparés : le mauvais riche va en Enfer et Lazare dans le sein d’Abraham, séjour des Justes avant la Résurrection du Christ. Il est souligné qu’il « a été établi un grand abîme » entre les deux, lequel est infranchissable (Lc 16, 26). Saint Paul confirme par ailleurs :
« Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ afin que chacun reçoive ce qui est dû à ses bonnes œuvres ou à ses mauvaises actions, pendant qu’il était revêtu de son corps » (2 Co 5, 10), ou enveloppe charnelle appelée « la tente » plantée sur la terre ; « Nous gémissons avec un ardent désir d’être revêtu de notre habitation céleste par-dessus la première » (2 Co 5, 2). Ce qui confirme que notre corps terrestre, dans l’Au-delà, sera devenu un corps céleste glorifié !
Enfin, la séparation de l’âme et du corps implique que chacun acquiert alors une destinée propre : l’âme, qui était en mouvement au cours de la vie terrestre, se retrouve « à l’état de terme », ce qui exclut désormais toute nouvelle acquisition de mérite ou de démérite. Lié à l’unicité de la mort et à celle du jugement que nous venons d’exposer, ce raisonnement exclut, à nouveau, toute réincarnation13.
Quant au corps qui est « poussière et retournera en poussière » (Gn 3, 19), saint Paul développe les différents arguments de sa « corruptibilité » et de « l’enveloppe mortelle » qu’il expose tout au long du chapitre 15 de sa première Épître aux Corinthiens.
L’apôtre des Gentils en parle d’autant plus librement qu’il a vécu, lui aussi, une extase semblable à une EMI : « Et je sais que cet homme — était-ce dans son corps ? était-ce sans son corps ? Je ne sais, Dieu le sait — » (2 Co 12, 3), sans pour autant en tirer de conclusion erronée, mais en rapportant bien cette impression de « décorporation ». L’apôtre Jacques le dit expressément : « le corps sans âme est mort » (Jc 2, 26)14.
Quelle valeur donner aux composantes, aux conséquences et au contexte des EMI, c’est-à-dire à elles-mêmes ?
Mise à part cette nécessité de rappeler la doctrine catholique face à certaines erreurs ou incertitudes, c’est bel et bien le Dr Charbonnier qui nous apporte la bonne réponse en ce qui concerne l’impression d’une « décorporation » : celle-ci ne peut être en fait qu’une projection de la conscience, processus analogue à la physique quantique, ce qui lui donne une sensation réelle. C’est d’ailleurs ce que dit Mgr Pascal Ide : « Si la décorporation décrite par les NDE[EMI] ne peut être objective [comme nous l’avons vu au paragraphe précédent], c’est qu’elle est subjective : elle est ressentie psychologiquement par la personne, mais non pas effectuée ontologiquement15. »
Par conséquent, la réponse, autant philosophique que théologique, s’illustre par l’observation ultime la plus simple : le corps est toujours visible à nos yeux et ne rentre pas pour autant en décomposition. La preuve en sera sa réanimation quelques instants plus tard.
Le fait qu’il existe, dans les EMI, une barrière infranchissable au-delà de laquelle les « expérienceurs » ne peuvent aller, en est une autre. Nous savons que nul ne revient de la mort, sauf en cas d’intervention divine comme dans les Saintes Écritures. Ainsi Moïse n’a-t-il pu voir Dieu que de dos (encore était-ce une image anthropomorphique) car Celui-ci lui avait dit : « Tu ne peux pas voir ma Face, car l’homme ne peut me voir et vivre » (Ex 33, 20). Saint Jean le rappelle : « Nul n’a jamais vu Dieu » (Jn 1, 18), ainsi que saint Paul : « À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse, mais alors, ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée, alors, je connaîtrai comme je suis connu » (1 Co 13, 12)16.
Il ne sera jamais possible de mesurer la conscience car il s’agit d’une faculté de l’âme spirituelle donc invisible. Sauf par grâce spéciale (cf. notes 5 & 6), elle n’est aucunement décelable mais ses effets le sont, comme toute activité spirituelle. Si bien que cette analogie avec la physique quantique permet à la science de retrouver cette évidence qu’elle avait perdue, à savoir que la personne humaine est composée d’une âme immortelle et d’un corps mortel, corruptible.
À ce titre, les EMI sont des signes de la Providence pour que la science abandonne un matérialisme désormais suranné, à condition qu’elle ait l’humilité de le reconnaître. Il est donc loisible de remarquer que les manifestations du gouvernement divin sont autant de signes de la miséricorde éternelle.
À partir du moment où les EMI actuelles s’identifient, comme nous l’avons vu, à celles du passé, il est difficile de nier qu’elles n’ont pas lieu sans la permission de Dieu. Dans notre XXe siècle rationaliste, les interventions de Dieu ou de ses anges, ou encore de ses saints, ne sont pas considérées, bien à tort, alors qu’elles sont innombrables depuis le début de l’humanité, et pas seulement chez les chrétiens. C’est un article de foi. Le livre de Pierre Jovanovic (cf. note 7) recense certaines manifestations d’anges gardiens, mais, en réalité, elles sont bien plus nombreuses qu’il ne le croit. Elles sont souvent considérées comme des « faits inexplicables », des « coïncidences » ou de la « chance », quand elles ne sont pas ignorées.
Si la Providence n’agissait pas de manière continuelle à travers les anges, nous serions livrés pieds et mains liés aux démons, Princes de la terre, purs esprits, anges rebelles bien supérieurs à nous par l’intelligence. Le hasard n’existe pas ou, plus exactement, « c’est le chemin qu’emprunte Dieu lorsqu’Il voyage incognito » énonce Albert Einstein, qui rajoute : « Dieu ne joue pas aux dés. » La Tradition catholique ne dit-elle pas que nos bonnes inspirations viennent le plus souvent de notre ange gardien ? L’ignorer ne correspond pas à la réalité, surtout si l’on considère la cause finale des EMI.
Il y a d’abord, selon le témoignage des « expérienceurs »qui l’ont vécu, cette « barrière infranchissable » qui ne permet pas de « voir Dieu face à face », limite interdite aux vivants. Une EMI est précédée d’abord d’une zone sombre qui permet une analogie avec le Purgatoire ou l’Enfer, puis par une approche progressive de la Vision béatifique, enfin par une post-monition de sa vie qui est un authentique examen de conscience. Il paraît donc difficile d’y voir une suggestion du Malin qui n’y gagne rien ; voyons-y au contraire un authentique signe de la miséricorde divine, ne serait-ce que pour l’« expérienceur », nous dit le Dr Theillier. Or, le Sauveur nous apprend que « vous les connaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des ronces ? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits ; mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits » (Mt 7, 16-18).
Lesquels fruits apparaissent spécialement positifs pour les « expérienceurs »: « leur vie avait gagné en profondeur », « en aucun cas elle [leur EMI] ne leur a inspiré l’idée d’un salut instantané ou d’une infaillibilité morale », souligne le Dr Van Lommel. « Les EMI, comme les miracles, transforment ceux qui les vivent […], elles peuvent provoquer des guérisons physiques ou psychiques », rapporte le Dr Theillier.
Le Dr Long se dit « fasciné par les nombreux récits faisant état de guérisons inattendues. Les mots « miracle » et « guérison » s’y répètent par dizaines17. »
Mêmes échos chez le Dr Sylvie Déthiollaz, biologiste, fondatrice du Centre Noêsis à Genève, qui rassemble des malades atteints du cancer. Pour l’un d’entre eux, c’est « comme si le bain de lumière [vécu pendant son EMI] avait donné la force de guérir à ses cellules ». Pour le Dr Theillier, le résultat d’une EMI est analogue à celui des miracles : à la fois guérison intérieure et extérieure. Lors du premier colloque tenu à Martigues sur les EMI, il a été dit que, pour certains « expérienceurs », les EMI sont comme « une psychanalyse accélérée, dans la mesure où la personne a accès à des informations, en général au cours de la revue de vie [cf. supra la 9e phase d’une EMI, ou le film rétrospectif de sa vie], qui vont lui permettre de comprendre l’existence d’un traumatisme très ancien, très enfoui jusque-là, et du pouvoir de les surmonter18. »
Enfin, en plus du refus catégorique d’évoquer la mort et l’au-delà en milieu médical, on peut constater depuis longtemps un rejet des fins dernières dans notre société actuelle. Mgr Aupetit l’explique par quatre causes : d’abord une modification du rapport à la mort dans le monde occidental à partir des années cinquante (marxisme, société de consommation…) ; ensuite la croyance en une vie après la mort qui semble s’être estompée, et cela même chez les chrétiens (conséquence d’un mauvais enseignement ?) ; puis l’engouement pour le syncrétisme et les religions orientales qui ont redonné consistance en la croyance, toute païenne, de la réincarnation ; enfin une volontaire remise en cause des fins dernières (modernisme) avec la parution de livres tel que La Naissance du Purgatoire (Paris, Gallimard, 1981) ; l’auteur, Jacques Le Goff, malgré les preuves inverses, y affirme que la notion d’un lieu de purification temporaire de l’âme ne remonte pas avant le XIIe siècle19.
En résumé, on peut distinguer plusieurs points providentiels dans les EMI. Ce sont : les bienfaits spirituels apportés aux « expérienceurs » et à leur entourage ; l’explication par une science qui prouve l’existence de Dieu ; le rappel que la mort n’est que le passage à la vie éternelle vis-à-vis duquel l’homme moderne est pris en flagrant délit de refus. Il y en a d’autres encore. Les EMI apparaissent donc comme autant de visions surnaturelles, c’est-à-dire ce que l’on nomme des phénomènes mystiques extraordinaires. Mais si ces derniers recueillent volontiers la croyance populaire, le Magistère de l’Église est autrement plus réservé à leur égard.
Le Magistère ecclésiastique sur les phénomènes mystiques extraordinaires, face à la contingence de ceux-ci
Paradoxalement, alors que le rôle de l’Église consiste à guider le salut spirituel de ses fidèles, son Magistère ne s’intéresse pas ou peu, sauf pour les condamner, aux phénomènes mystiques extraordinaires (apparitions, révélations, extases, stigmates, etc.). Pourtant, beaucoup de ces mêmes fidèles, entre autres parmi les plus motivés, vivent leur foi grâce à ceux-ci. Ainsi la théologie dogmatique, qui les déclare subjectifs par définition20, donc non-normatifs, précise qu’ils ne sauraient s’ajouter en aucune manière, sous peine d’hérésie, à la Révélation conclue avec la mort du dernier Apôtre. La théologie morale, de son côté, ne peut que les ignorer étant donné qu’ils sont trop incertains.
La théologie fondamentale, qui donne le degré de foi à attribuer à chaque donnée de la Tradition, non seulement ne les classe pas parmi les « dix lieux théologiques », mais pas davantage dans les « lieux annexes » comme la philosophie, le droit ou l’histoire. Enfin la théologie mystique, dont la principale référence est saint Jean de la Croix, docteur de l’Église, met radicalement en garde contre ce qu’elle considère comme des superfluités orgueilleuses et malsaines21.
Cette sévérité est compréhensible, car quelle que soit la première grâce qui entraîne la conversion, l’Église insiste sur le fait que le Salut est avant tout une affaire objective qui demande un appel à la raison pour tous les hommes, sinon son message n’est pas universel. Et toute grâce personnelle, si extraordinaire soit-elle, ne peut être que subordonnée à cette universalité. On peut, en plus, invoquer un jugement prudentiel de l’Église, non seulement face au bénéficiaire de grâces personnelles, mais aussi face au monde envers lequel elle engage sa crédibilité.
Si les phénomènes mystiques extraordinaires ne sont jamais tenus pour « certains » au sens d’un dogme de foi22, cela ne signifie pas pour autant qu’ils ne soient pas véridiques. Certes, le Magistère de l’Église ne les cautionne pas, mais il reconnaît qu’on peut leur donner une adhésion personnelle :
« Lorsque l’assentiment de foi catholique ne doit pas ou ne peut pas être donné, un assentiment de foi humaine peut être dû, suivant les lois de la prudence, et selon l’avis que ces révélations sont probables et sont à croire pieusement23. »
Quant au Catéchisme de l’Église catholique (n°67), il rappelle qu’en ce qui concerne « les révélations dites privées dont certaines ont été reconnues par l’autorité de l’Église, elles n’appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n’est pas d’améliorer ou de compléter la Révélation définitive du Christ, mais d’aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l’histoire ». Et il fait appel au sensus fidelium , « le sens des fidèles » (découlant du sensus fidei « le sens de la foi ») qui, « guidé par le magistère de l’Église » , sait « discerner et accueillir » ce qui, dans ces révélations, est un appel authentique du Christ.
Cela s’inscrit dans la lignée du concile de Trente, qui déclare que Dieu peut donner une certitude à ceux qui bénéficient d’une révélation personnelle, et cela indépendamment du jugement de l’Église24. Dans ce cas, expose saint Thomas d’Aquin, « la loi de la conscience, à partir du moment où elle est juste, oblige car elle devient à l’image de la loi divine » : c’est le dictamen rationis, ce qui s’impose à la raison25. Telle est bien la conviction des « expérienceurs ».
À la lumière de ces enseignements, il apparaît difficile de partager les conclusions de Mgr Corrado Balducci lorsqu’il explique qu’ « il est hors de question de voir une preuve de la vie après la mort dans les NDE [EMI], car les preuves de la vie après la mort sont données seulement par la Parole de Dieu. On peut les concevoir comme une grâce de Dieu. Mais nous ne devons pas les rechercher. Dieu désire notre foi. Si quelqu’un croit à une vie post-mortem parce qu’il a vécu une telle expérience, alors il commet une grossière erreur26. »
De même, l’attitude critique, peu justifiée, du père jésuite Join-Lambert de l’université de Louvain est aussi discutable. Heureusement, il conclut que le rôle de l’Église n’est pas de juger les EMI, mais de les interpréter27.
Au contraire, la position de Mgr Aupetit nous semble plus positive, plus réaliste et finalement plus conforme au devoir de pasteur, car il concrétise cette interprétation des EMI en exposant à nouveau le Magistère de l’Église sur les fins dernières, ce que l’on a vu précisément discuté. C’est aussi, à une autre échelle, le raisonnement du Dr Theillier dont le livre a été préfacé par Mgr Aillet, évêque de Bayonne. Il multiplie les parallèles entre composantes d’une EMI et Tradition de l’Église28, illustrant ses propos par des homélies et des références (une vingtaine) tirées de la Sainte Écriture ou d’auteurs spirituels (une dizaine), n’hésitant pas à se justifier en citant saint Jean de la Croix, saint Thomas d’Aquin, sainte Marguerite-Marie Alacoque ou le père Sertillanges.
Difficilement méconnaissables par une multiplication sans précédent, « aussi authentiques que toute autre perception humaine, aussi vraies que les maths et aussi indubitables que le langage » selon le Dr Melvin Morse, les EMI, par les questions qu’elles soulèvent, apparaissent également pour l’Église comme autant de signes de la Providence.
Une bonne interprétation s’avère donc nécessaire, à l’image de Mgr Aupetit et du Dr Theillier, lesquels suivent la trace, une fois n’est pas forcément coutume, des cardinaux Congar et Rahner, obligés en leur temps de se pencher sur ce problème épineux des faits surnaturels.
Pour aller plus loin
Nous avons essayé de faire un tour d’horizon sur la triade annoncée en introduction, les EMI, la science et l’Église. S’il est difficile de conclure sur un sujet toujours en cours, deux axes de recherches sont proposés au lecteur, pour qu’en plus de la lecture des livres utilisés pour l’exposé il puisse se faire une idée de ce domaine situé à la frontière de la science et de la vie surnaturelle.
Le premier est scientifique. Le cerveau restant encore à explorer, il sera de plus en plus nécessaire, avec le temps et les manipulations en tout genre, de connaître scientifiquement ses différentes possibilités dans le domaine spirituel, possibilités encore méconnues. Tels sont les éléments donnés par le livre Du Cerveau à Dieu29 que le Dr François Plantey, lors du Colloque 2017 du CEP a déjà présenté.
Le second axe est plus spirituel et concerne la frontière existant entre paranormal et surnaturel, parfois peu aisée à reconnaître. Beaucoup de facettes de cette nébuleuse sont répertoriées dans le livre, facile à lire, de l’abbé Cyrille Debris, lequel porte sur l’intervention du surnaturel dans la vie de l’impératrice Zita30.
Nous espérons qu’il permettra au lecteur, sur le sujet, de séparer le vrai du faux et de mieux distinguer l’important de l’accessoire.
1 Tous les arguments qui suivent se retrouvent dans les ouvrages déjà cités, mais sont particulièrement développés dans celui du Dr Van Lommel.
2 Ibid., op. cit., p. 232 ss. (cf. note 10).
3 Cf. § « Multiplication des EMI » dans la 1ère partie.
4 Cf. chapitres 10 & 11 de Mort ou pas du Dr VAN LOMMEL (cf. note 10).
5 La physique quantique n’a jamais formé un tout, et ses tenants se divisent sur ce qu’elle est comme sur ses applications. Prenons un exemple : malgré les doutes encore émis, la physique quantique mesure bel et bien le corps humain grâce à l’antenne de Lecher (inventée par le physicien du même nom) qui fonctionne un peu comme le radar (envoyer des ondes et en recevoir selon un barème établi à l’avance), mais à peine plus grand qu’un ustensile de cuisine. Elle permet de quantifier les trois champs énergétiques du corps, vibratoire (rayonnant), profond (centripète), de surface (centrifuge) jusqu’à plus d’une dizaine de mètres de décalage (à ne pas confondre avec la prétendue théorie du « corps astral » ; cf. infra.). On l’utilise ainsi dans le cadre d’une méthode énergétique (le ministère de l’Intérieur lui a rappelé qu’elle ne devait pas porter le nom de « médecine ») appelée ACMOS. L’antenne peut également mesurer chaque organe, son environnement, ses agressions, etc. Cf. https://acmos-sbj.com/.
6 On constate que le Dr Van Lommel ne porte aucun jugement moral sur certains sujets (ex. : transe chamanique) alors que nous serions en droit de le faire. Son but est surtout de prouver sa théorie. Nous analyserons en 3e partie ses quelques erreurs de conclusion.
7 Bref résumé des écrits du Dr Charbonnier comprenant la partie théorique du livre éponyme (cf. note 11), du livre Les 7 bonnes raisons de croire à l’au-delà (cf. note 6), enfin de la préface du livre du Dr Van Lommel, Mort ou pas (cf. note 10) .
8 Le physicien Emmanuel RANSFORD, qui a écrit la postface du livre Les 7 bonnes raisons de croire en l’au-delà, explique qu’il existe encore d’autres preuves pour affirmer l’existence de Dieu et expliquer le processus de la mort. Lui aussi utilise la physique quantique : au moment de la mort, grâce au « psy » des quanta (aléatoire et endo-causal), la conscience devient la « métaconscience », « ensemble des informations suprales déposées tout au long de notre passage terrestre sur cette grande toile suprale non locale », tandis que la matière, de son côté, se projette en«psycho-matière » dans un endroit non-local grâce à sa signature (nous renvoyons au paragraphe précédent). Il évoque aussi ce qu’il appelle l’ « ur-causalité », conséquence de l’endo-causalité, Principe-créateur (qui n’appartient pas à ce monde) auto-régénérateur « ur-causal et transcendant » et non pas « ur-supral et immanent » comme le principe qui régit les phénomènes de la conscience.
9 Dans ces domaines où le paranormal touche au surnaturel (cf. § en fin d’exposé : « Pour aller plus loin »), il est difficile de discerner les permissions divines. En tout cas, le Dr Charbonnier ne néglige pas le fait d’avoir recours à la prière. Toutefois, lui non plus ne porte aucun jugement sur ce qu’il écrit : c’est ainsi qu’il croit à la réincarnation, ce à quoi nous répondrons en notre 3e partie.
10 Il est difficile de se prononcer sur ce dernier cas. Faut-il leur donner une explication naturelle comme le Dr Charbonnier le sous-entend, ou parfois une explication surnaturelle comme le montre parfois la Sainte Écriture ?
11 On peut encore ajouter, pour expliquer les EMI, la tentation d’un syncrétisme religieux ainsi que l’attraction des religions asiatiques, comme le bouddhisme et le Livre des morts tibétain qui rapporte, au moment de la mort, la « fusion dans un Grand Tout ».
12 La mort est un châtiment, la peine du péché originel (Gn 2, 7-19 et 3, 3), car Dieu « n‘a pas fait la mort » (Sg 1, 13), « Dieu a créé l’homme pour un état d’incorruptibilité » (Sg 2, 23).
13 Les rappels du « Jour du Salut » et du « Jour du Jugement » sont innombrables dans la Sainte Écriture.
14 Le même raisonnement conduit à l’absence de « corps astral », contrairement à ce que l’occultisme veut bien faire croire à ses initiés.
15 Pascal IDE, art. « Near Death Experience », Dictionnaire des miracles et de l’extraordinaire chrétiens, sous la dir. de Patrick Sbalchiero, Paris, Fayard, 2002, p. 566-568.
16 Les EMI révèlent des images étonnantes : l’un a vu son ange gardien habillé de vert, l’autre en veille dame, et très souvent, nous l’avons dit, habillé de lumière. On peut aussi relever l’énorme papillon volant multicolore sur lequel le Dr Eben Alexander fit son EMI. Mis à part un humour certain voulu par l’ange gardien (le Padre Pio n’est-il pas apparu habillé en Hindou lors d’une apparition !), le lecteur ne doit pas s’inquiéter de ces perceptions parfois étonnantes de la conscience, car celles-ci révèlent que l’âme n’est pas encore au Ciel, même si elle en a une approche par permission divine (cf. infra : « Pour aller plus loin »).
17 Citations du Dr Patrick THEILLIER, p. 179 ss. de son livre Expériences de mort imminente, Paris, Éd. Artège, 2015, (cf. n. 12, Ière partie).
18 Idem.
19Mgr Michel AUPETIT, LaMort, et après ? (cf. n. 3, Ière partie), p. 84. Il cite ses sources et la vie paroissiale le confirme. Remarquons que ce refus du Purgatoire marque une vraie régression spirituelle quand on constate que, même chez les animistes africains, il existe un temps de purification après la mort…
20 Y compris à Fatima, en 1917, où le soleil a tourné devant 70 000 personnes. Dans ce cas, on parle d’intersubjectivité.
21 « L‘âme pure, simple, prudente, humble, doit employer toutes ses forces et toute sa diligence à repousser et rejeter les révélations et les visions comme les plus dangereuses tentations » (saint JEAN de la Croix, La Montée du Carmel, 2, C 27, Œuvres spirituelles, Paris, Seuil, 1929). Le 3e chap. du livre III du très classique Précis de Théologie ascétique et mystique de l’abbé Adolphe TANQUEREY (Louvain, Desclée & Cie, réédit. 1956), consacré aux phénomènes mystiques extraordinaires, illustre ce propos. N. B. : avant le 14 octobre 1966, le Droit canon de 1917 interdisait toute publication sur les apparitions non reconnues et punissait les contrevenants d’excommunication. L’actuel Droit canon est muet sur le sujet.
22 À ce titre, l’expression non constat supernaturalitas (« le surnaturel n’estpas prouvé ») est trompeuse, car il ne sera jamais possible de prouver le surnaturel. Par conséquent, si l’argument précise que l’Église ne s’engage pas officiellement, il ne remet nullement en cause l’authenticité des faits.
23 Décret De servorum Dei beatificatione de Benoît XIV en 1747 (livre II, ch. 32, n° 11). Prenons une application avec les apparitions de Lourdes, au sujet desquelles la Congrégation des rites a précisé en 1877 (postérieurement à la reconnaissance des apparitions), en s’appuyant sur le même décret : « Ces apparitions ne sont ni approuvées ni condamnées par le Saint-Siège, qui a autorisé qu’on y croie par une foi purement humaine, sur la tradition de ce qu’elles relatent, corroborées par les témoignages et les documents dignes de foi » (cf. Introduction au Dictionnaire des apparitions de la Vierge Marie, Fayard, 1977). Selon le même Dictionnaire, le pape saint Pie X disait l’équivalent à condition « que les motifs de foi ne fassent pas défaut ».
24 Décret sur la justification, Denzinger, n° 1 540 & 1 566.
25 Commentaire du Livre des Sentences, II, d.24, q.2, a.4, obj.2. Cette situation est parfois déchirante pour les voyants d’une apparition non reconnue, et plus encore lorsqu’elle est condamnée.
26 Life Magazine, mars 92, p. 71. La déclaration de feu Mgr Balducci, ancien théologien de la Curie et exorciste de Rome, est d’autant plus piquante qu’il fut un défenseur des OVNI et de la pluralité des mondes habités… (https://forum-ovni-ufologie.com/t4443-deces-de-monseigneur-balducci)
27 Arnaud JOIN-LAMBERT, Les Expériences de mort imminente. Hallucinations ou lumières sur l’au-delà ?, Namur, Fidélité, 2010. Cf. aussi son entretien sur le site Aleteia :
https://fr.aleteia.org/2017/08/28/experiences-de-mort-imminente-la-mise-en-garde-dun-theologien/. On le sent désabusé dans ses propos.
28 Comme le fit également Mgr Léonard, ancien évêque de Namur et ancien archevêque de Malines-Bruxelles.
29 Mario BEAUREGARD & Denise O’LEARY, Du Cerveau à Dieu. Plaidoyer d’un neuroscientifique pour l’existence de l’âme, Paris, Guy Trédaniel, 2015.
30Cyrille DEBRIS, De Choses et d’autres. Le surnaturel dans la vie del’impératrice Zita, Paris, Presses de la Délivrance, 2018. N. B. : L’auteur, prêtre du diocèse de Rouen, est postulateur dans le procès en béatification de l’impératrice Zita.
